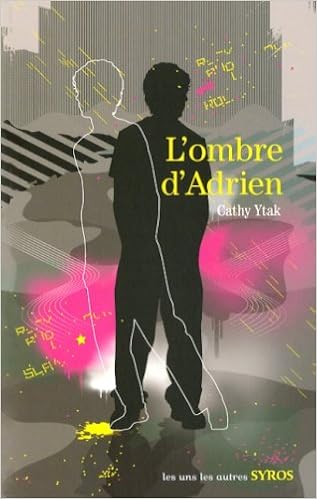Anne Percin, L’Âge d’Ange, L’école des loisirs, « Médium », 2008.
 L’Âge d’ange est le troisième roman d’Anne Percin que je lis et il me confirme dans la très grande affection que j’ai pour ses livres et sa maestria de romancière (« pour la jeunesse » jusqu'ici — en attendant son premier opus hors de ce registre, Bonheur fantôme, annoncé pour août 2009 aux éditions du Rouergue). En novembre 2006, j’ai découvert Point de côté grâce à Thomas Gornet et ce fut un régal. La littérature estampillée « jeunesse » m’en procure rarement à ce degré. Et pour ce qui est de raconter « l’amour au masculin pluriel » (Romain Didier) à un lectorat adolescent, seuls La danse du coucou d’Aidan Chambers et Frère de Ted van Lieshout m’ont remué à un niveau équivalent.
L’Âge d’ange est le troisième roman d’Anne Percin que je lis et il me confirme dans la très grande affection que j’ai pour ses livres et sa maestria de romancière (« pour la jeunesse » jusqu'ici — en attendant son premier opus hors de ce registre, Bonheur fantôme, annoncé pour août 2009 aux éditions du Rouergue). En novembre 2006, j’ai découvert Point de côté grâce à Thomas Gornet et ce fut un régal. La littérature estampillée « jeunesse » m’en procure rarement à ce degré. Et pour ce qui est de raconter « l’amour au masculin pluriel » (Romain Didier) à un lectorat adolescent, seuls La danse du coucou d’Aidan Chambers et Frère de Ted van Lieshout m’ont remué à un niveau équivalent.Anne Percin aime bien faire des cachotteries à ses lecteurs en dévoilant sur le tard quelques clés tenues dans une manche : aussi bien dans Point de côté que dans Servais des collines, elle utilise secrets et ellipses comme autant de tours d’illusionniste. Mais ce qui était un jeu parmi d’autres dans ces romans joue un rôle central dans L’Âge d’ange. Comme l’a déjà dit Blandine Longre, la très grosse difficulté que ce roman pose à qui veut en rendre compte réside dans son système de révélations graduelles : si on dévoile ses énigmes sans précautions, on ruine l’un des charmes majeurs du livre…
Quand je rêvais parmi les rayons, on m’aurait posé une colle si on m’avait demandé, à mon tour de dire qui j’étais.
Enfant ou vieillard ? Garçon ou fille ? Je ne savais pas.
Longtemps, je n’ai pas su. J’étais un ange, peut-être. Un ange qui attend la chute (p. 20)
On appelait notre lycée le gymnasium.
Dans la ville haute, c’était un grand établissement de bonne réputation, fondé il y a des siècles. Les élèves comme Tadeusz, on pouvait les compter sur les doigts d’une main. Des deux mains à la rigueur. On savait d’où ils venaient : de quartiers dont les seuls noms faisaient peur à nos parents. On savait que les profs les préféraient parce qu’ils en avaient bavé pour parvenir là où nous avions atterri sans effort. […] (p. 12)
De cette rencontre improbable, faite d’affinités secrètes et de malentendus, le lecteur va lentement découvrir les étapes, certaines prévisibles, d’autres beaucoup moins. Pour notre plus grand plaisir, d’innombrables petits signes avant-coureurs sont dissimulés dans le récit, qui anticipent la suite ou trompent le monde (on ne peut jamais savoir à l’avance). Et ce qui avait au départ des dimensions allégoriques se revêt de chair (ou de réel), au fur et à mesure que l’ange s’extrait de sa chrysalide (un motif récurrent depuis Point de côté). Le conte devient roman, la topologie sociale tourne à la lutte des classes. Mais pas complètement, car l’indistinct est assurément le motif du livre, et ce qui en fait l’originalité. Il en va ainsi du cadre géographique — la ville de Luxembourg — qui pourrait enraciner le récit mais garde finalement une dimension assez abstraite. Garçon ou fille, imaginaire ou réel, allégorie ou fiction ancrée dans un lieu et une époque, etc. : L’Âge d’ange s’emploie à brouiller les pistes, même si le chemin que l’on emprunte va plutôt vers l’élucidation des énigmes. En cela, le livre est du côté des Lumières, foncièrement, de même qu’il porte une voix assez politique.
Pour tenir les difficultés de l’indistinct dans une langue aussi genrée que le français, où presque chaque mot doit prendre parti entre masculin et féminin, Anne Percin s’est donnée un cahier des charges de funambule (exercice que ne désavoueraient pas les amateurs de contraintes, façon Oulipo). Pour éviter de trahir le sexe de son ange, en particulier, elle louvoie avec une adresse malicieuse. Et quand finalement elle « lâche » le morceau, c’est avec un à-propos dramatique qui donne tout son sens à ce qui précède et à ce qui suit la révélation. Et malgré tout, c’est une avancée toute relative pour le lecteur, car il n’est pas sorti pour autant des leurres (et des heurts). En outre, il ne s’agit pas simplement d’un jeu littéraire. C’est aussi une façon de refuser toutes les assignations, qu’elles soient de sexe, de genre, de famille, de condition sociale, etc.
Davantage encore que dans ses romans précédents, elle s’autorise une discrète licence poétique, servie par une langue caméléon : familière parfois, mais à dessein, prosaïque souvent, souveraine la plupart du temps, heurtée ou déroulée. La part des dialogues s’est accrue, signe de confiance chez une prosatrice qui semblait plus à l’aise dans l’exercice d’une voix singulière. Les alinéas sont brefs, comme autant d’élans ou de palpitations. Il en surgit souvent des astuces ou de l’ironie. C’est aussi un geste léger pour se saisir des catastrophes…

Car L’Âge d’ange se donne, et ce assez précocement, comme un livre tragique. L’annonce en est esquissée dès le premier chapitre. Elle reviendra souvent. On pourrait la prendre à la légère. Et pourtant, en l’occurrence, ce n’est pas une feinte. D’une certaine manière, tout est fait pour que le lecteur redoute cette issue funeste. Elle n’en est que plus pénible, au fur et à mesure qu’elle se précise. Pourtant, elle ne résonne pas à la façon des tragédies classiques, plutôt comme un appel à la révolte (ou à la Révolution ?).
Au regard d’autres romans chroniqués ici, notamment au rayon « jeunesse », la vision de la condition des jeunes homos pourra sembler sombre ou pessimiste. Une fois le thème « SIDA » (avec son cortège de morts) désamorcé, la littérature jeunesse en français était devenue assez optimiste concernant les personnages LGBT. On pourrait se réjouir du stock de positivité qu’elle véhicule désormais. Pourtant, il lui manque un peu de la noirceur que se coltinent certains romans en anglais, en prise directe sur l’expérience du harcèlement. Alors, L’Âge d’ange est loin d’être un roman « sur » la tragédie de l’homophobie (d’ailleurs, les romans sur font de la mauvaise littérature à coup sûr), et le cassage de pédé s’accomplit ici dans une ellipse. Mais c’est une piqûre de rappel contre tout angélisme !