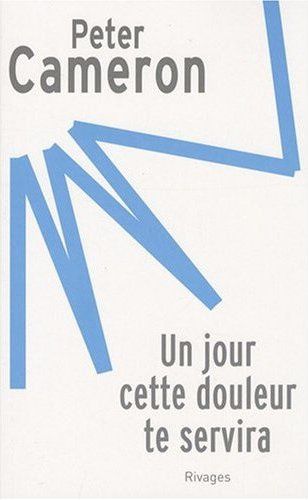 Depuis 1995, les éditions Rivages ont fait montre d’une fidélité exemplaire à l’égard de Peter Cameron : Un Jour cette douleur te servira est son cinquième roman traduit, outre un recueil de nouvelles paru en 2006, Au Beau Milieu des choses. Ses premiers romans, Week-end et Année Bissextile, étaient des chroniques douces-amères portraiturant la vie des gays cultivés new-yorkais. Le rapprochement avec des auteurs comme Stephen Mac Cauley ou David Leavitt était alors assez tentant, même s’il y a une finesse et une élégance dans les premiers livres de P. Cameron qui les distingue.
Depuis 1995, les éditions Rivages ont fait montre d’une fidélité exemplaire à l’égard de Peter Cameron : Un Jour cette douleur te servira est son cinquième roman traduit, outre un recueil de nouvelles paru en 2006, Au Beau Milieu des choses. Ses premiers romans, Week-end et Année Bissextile, étaient des chroniques douces-amères portraiturant la vie des gays cultivés new-yorkais. Le rapprochement avec des auteurs comme Stephen Mac Cauley ou David Leavitt était alors assez tentant, même s’il y a une finesse et une élégance dans les premiers livres de P. Cameron qui les distingue.
Avec son troisième roman traduit, Andorra, il a opéré un virage ambitieux et risqué : délaissant le domaine balisé de la « littérature gay » de divertissement, il y décrivait l’errance intérieure d’un homme peu à peu délaissé dans une principauté sournoisement oppressante. À l’image de son héros-narrateur, il s’agit d’un roman peu amène et assez opaque, qui évoque L’Invention de Morel d’Adolfo Bioy Casarès et la superbe nouvelle La Rive asiatique de Thomas Disch. Mais rien qui soit de nature à susciter un engouement immédiat.
De fait, Peter Cameron demeure un auteur assez confidentiel, rarement mis en avant par la critique, méconnu du grand public. C’est un miniaturiste, un artiste de la nuance, du quotidien infime, en contraste radical avec le tapage qui fait souvent le succès des écrivains made in USA (faut-il des noms ?). Pourtant, il gagne à être lu : ses talents de dialoguiste, son sens du détail, son humour discret sont un vrai bonheur.
À ce titre, Un Jour cette douleur te servira est sans doute son livre le plus séduisant. Raconté par un jeune homme de dix-huit ans fraîchement sorti du lycée, James Sveck, à l’esprit on ne peut plus aigu, ce roman signe le retour de Peter Cameron au biotope bourgeois new-yorkais de ses premiers romans. La narration est supposée se passer entre le 24 et le 30 juillet 2003, et revêt en apparence l’aspect d’un journal intime, même si certains chapitres renvoient à des épisodes antérieurs et prennent alors une autre forme narrative. James raconte un quotidien ronronnant avec une verve désenchantée. L’ironie de ses descriptions permet à l’auteur, dans un jeu de miroir assez subtil, de suggérer beaucoup sur la psyché du jeune homme.
L’allée des chiens est une partie entièrement clôturée du jardin public, et une fois que l’on a franchi les deux portillons qu’il ne faut jamais, sous peine de mort, ouvrir simultanément, on peut enlever la laisse à son animal et le laisser batifoler avec ses congénères. À mon arrivée vers quatre heures de l’après-midi, l’allée se trouvait presque déserte. Les gens plus ou moins sans travail qui la fréquentaient durant la journée étaient partis et les autres n’étaient pas encore là. Restaient quelques personnes rétribuées pour promener leur assemblage hétéroclite de chiens, dont aucun ne paraissait d’humeur à batifoler. Miró a gagné au petit trot notre banc favori, par chance dans l’ombre à cette heure-là, et il a grimpé dessus. J’ai pris place à côté de lui mais il m’a tourné le dos d’un air indifférent. Alors que Miró est un animal très affectueux dans l’intimité de la maison, il se comporte à l’extérieur comme un adolescent qui néglige l’affection parentale. Il estime, je suppose, qu’agir autrement pourrait nuire à son attitude « je-ne-suis-pas-un-chien ».
Ce coin à part engendre un esprit confraternel que je déteste. Une espèce de camaraderie privilégiée entre propriétaires de chiens qui, selon eux, autorise les familiarités. Si j’étais assis sur un banc ailleurs dans le jardin public, personne ne m’aborderait, mais dans l’allée des chiens j’ai l’impression de me trouver sur je ne sais quelle planète lointaine où règneraient des moeurs excessivement amicales. « Ah ! le beau caniche, il a un pedigree ? » va-t-on me demander, ou « C’est un garçon ou une fille ? », ou n’importe quelle autre question idiote. Heureusement, en professionnels qu’ils sont, les promeneurs rétribués ne parlent qu’entre eux, de même que les nounous et les mères, je l’ai remarqué, ne se mélangent jamais dans l’aire de jeux à l’instar des promeneurs rétribués et des propriétaires de chiens, chacune se confine à ses semblables. Donc, on nous a laissés tranquilles, Miró et moi. Après avoir observé un moment les autres chiens, Miró a soupiré et s’est lentement affaissé sur le banc, me poussant un peu avec ses pattes de derrière pour avoir toute la place de s’allonger. Mais, comme je refusais de me déplacer, il a par force laissé pendre sa tête au bout du banc. La manière dont il l’a fait exprimait clairement combien la condition canine était dure. [p. 20-21]
Si le quotidien de James semble on ne peut plus monotone, on ne saurait en dire autant de ses réactions insolites, qui jettent le trouble dans un univers policé. Un épisode de fugue arrivé au printemps précédent, ou encore un mauvais tour joué au collaborateur de sa mère (directrice d’une galerie d’art), sont autant d’actes manqués par lesquels le personnage exprime un désarroi que sa retenue sophistiquée condamne au silence.
Le problème principal, c’est que je n’aime pas les gens en général, ceux de mon âge en particulier, et que les étudiants sont des gens de mon âge. J’irais plus volontiers à l’université s’il s’agissait d’une université pour les vieux. Je ne suis pas un inadapté social ni un dingue (quoique les inadaptés sociaux et les dingues ne s’identifient sans doute pas comme tels) ; simplement, je ne trouve aucun plaisir à être avec des gens. Ils échangent rarement des propos intéressants, du moins d’après mon expérience. Ils racontent leur vie, qui ne présente pas grand intérêt. Alors l’impatience s’empare de moi. On ne devrait parler, me semble-t-il, que si l’on a quelque chose d’intéressant à dire ou qui nécessite d’être dit. Je n’avais jamais pris conscience des difficultés auxquelles ces sentiments m’exposaient, jamais vraiment, avant ce qui m’est arrivé au printemps dernier. [p. 44-45]
Fâché avec ses contemporains, réfractaire à toute comédie sociale, les récits de James suggèrent en creux et comme incidemment son enfermement dans une vie contemplative. À la surface des dialogues étincelants que lui cisèle Peter Cameron, il apparaît spirituel. Mais c’est un brio que trouble une profonde fêlure, qui parfois se manifeste ouvertement.
« Nous avons donc déjeuné ensemble, [ton père et moi], reprit maman d’un ton un peu plus normal. Pour nous entretenir à ton sujet. Et l’idée nous est venue que tu aimerais peut-être parler à quelqu’un.
— Parler à quelqu’un ? Tu viens de mentionner mon caractère taciturne. Pourquoi j’aurais envie de parler à quelqu’un ?
— Il ne s’agit pas d’un « quelconque » quelqu’un, mais de quelqu’un dont c’est la spécialité. Thérapeute. Psychiatre. Quelqu’un comme ça. Tu veux bien, James ? Tu veux bien le faire pour moi ? Et pour ton père. S’il te plaît, cesse un moment de tout rejeter et va parler à cette dame.
— Une dame ?
— Oui, une dame.
— Qui l’a choisie ?
— Ton père. Je savais que tu rejetterais automatiquement toute personne suggérée par moi.
— Bon, tu l’admettras, tes expériences avec les thérapeutes n’ont pas abouti à grand-chose. »
Maman se tut.
Je demandai : « Comment elle s’appelle ?
— Rowena Adler. Le docteur Rowena Adler. Elle est psychiatre.
— Rowena ? Vous m’envoyez chez une psy qui s’appelle Rowena ?
— Qu’as-tu contre ce prénom ? C’est un prénom irréprochable.
— Oui, peut-être, pour un personnage d’opéra wagnérien. Mais ça ne fait pas un peu teuton, d’après toi ?
— Tu deviens ridicule, James. Tu ne peux pas rejeter cette psy à cause de son héritage culturel. Ton père s’est renseigné autour de lui et, apparemment, elle est très bien.
— Ah ! m’exclamai-je, ça me rassure. Une psy qui a l’approbation des collègues cinglés de papa.
— Ton père a des relations. Il peut trouver le meilleur avocat de divorce, alors pourquoi pas la meilleure psy ? Il a consacré à cette recherche beaucoup de temps et d’efforts, et tu sais que ce n’est pas dans sa nature. Des personnes qui s’y connaissent ont hautement recommandé le Dr. Adier. En fait, sa spécialité est...
— Quoi? Quelle est sa spécialité ? Les garçons de dix-huit ans taciturnes et insatisfaits ?
— Oui, répliqua maman. C’est précisément sa spécialité. Elle s’occupe des adolescents perturbés.
— Ah bon, voilà ce que je suis ? Le terme ne me paraît pas très politiquement correct. On devrait trouver mieux, non ? Ne pourrais-je pas être un adolescent à part ? Ou un adolescent aux aptitudes différentes ? Ne pourrais-je... »
Maman allongea le bras et plaqua la main sur ma bouche. « Arrête, dit-elle. S’il te plaît, arrête. »
Sa main contre mon visage me donnait une sensation bizarre. Une sensation d’intimité déroutante : elle ne m’avait pas touché depuis si longtemps que je ne m’en souvenais plus. Elle resta un long moment ainsi, la main sur ma bouche. Puis elle la retira. « Excuse-moi. Je n’aurais pas dû... je voulais seulement...
— Non. Tu as raison. C’est vrai.
— Qu’est-ce qui est vrai ?
— Que je suis perturbé », répondis-je. Je réfléchissais au sens de ce mot, à ce que cela signifie au juste d’être perturbé, comme l’eau d’une mare est perturbée lorsqu’on y jette une pierre, ou comme on perturbe la paix. Ou encore comme on peut être perturbé par un livre, un film, les incendies de forêts pluviales ou la fonte des calottes glaciaires. Ou par la guerre en Irak. Je vivais l’un de ces instants où on a l’impression d’entendre le mot pour la première fois, on ne peut pas croire qu’il signifie ce qu’il signifie et on s’interroge : comment ce mot en est-il venu à signifier cela ? C’était pareil à un son de cloche, éclatant et pur, perturbé, perturbé. J’entendais retentir sa signification, et j’ai dit, comme si je m’en rendais compte tout à coup: « Je suis un garçon perturbé. » [p. 71-73]
Il serait tentant de citer nombre d’autres passages, tant le roman propose un contraste séduisant entre une écriture astucieuse et drôle et une situation qui apparaît d’une sourde tristesse. Il y a là sans doute le ressort principal du charme particulier qui émane de ces pages. James est au demeurant dans la longue lignée de ces personnages post-adolescents inoubliables des teen novels de langue anglaise : Holden Caulfield dans L’Attrappe-cœurs de J.D. Salinger, Phineas dans Une paix séparée de John Knowles, Hal dans La Danse du coucou d’Aidan Chambers, etc. À ce titre, c’est un livre que l’on pourrait recommander aussi pour de grands adolescents.
En revanche, parler de « roman d’éducation » comme le fait l’éditeur est assez discutable : si le récit de cet été perturbé suggère sans doute un tournant dans l’existence du personnage, on ne saurait dire que le lecteur assiste à autre chose qu’une prise de conscience (et encore est-elle très fragmentaire). Peter Cameron s’empare d’un moment fugitif sans l’ampleur et la lourdeur de procédé des bildungsroman. Et il s’agit surtout d’une « déséducation », dans la mesure où l’extrême raffinement intellectuel du personnage apparaît comme l’un des piliers de son aliénation (douce).
Un Jour cette douleur te servira pourrait bien être le livre d’une plus juste reconnaissance de Peter Cameron en France. À la fois subtil et très accessible, drôle et touchant, il concilie la veine new-yorkaise des débuts et les ambitions littéraires des œuvres suivantes. La traduction de Suzanne Mayoux restitue l’élégance nonchalante et la clarté à proprement parler classique du texte anglais. On ne pouvait demander davantage.
Publication initiale de cette chronique dans Sitartmag.
