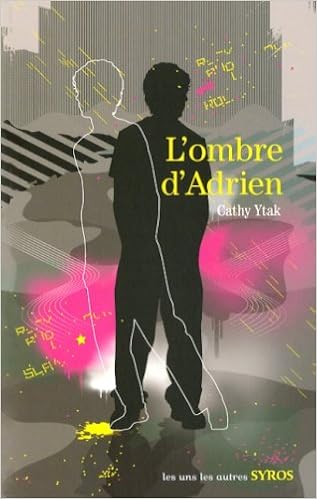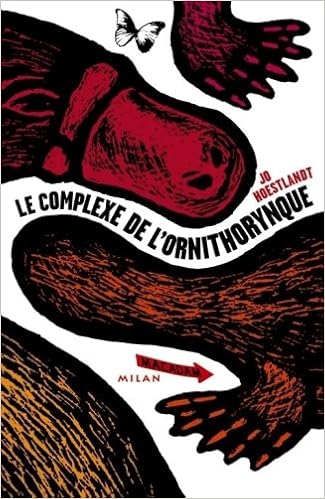Peter Cameron, Someday, This Pain Will Be Useful To You. New York: Frances Foster Books, 2007. Voir l'annonce de la traduction française
Peter Cameron est un écrivain au statut paradoxal en France : largement traduit (par les éditions Rivages), disponible en poche, mais bénéficiant d’une notoriété très maigre. J’ai d’ailleurs noté seulement deux commentaires sur amazon pour cinq livres traduits, et je n’ai jamais vu passer de critiques dans la presse que je lis. J’imagine qu’il doit bien être évoqué de temps en temps et avoir des lecteurs. Sinon, cela fait longtemps qu’il ne serait plus traduit : c’est ce qui s’est passé pour Jim Grimsley, dont plus rien n’a été traduit depuis Dream Boy en 2003, alors qu’il a abondamment publié ces dernières années…
La production de Peter Cameron a un air de famille avec celle de Stephen MacCauley, même si elle ressortit moins à la littérature de divertissement et s’empare de sujets plus graves. Année bissextile (Leap Year, 1990) et Week-end (1994) sont des romans ligne claire chroniquant la vie de gays new-yorkais à diverses étapes de leur vie. Andorra (1997) — fable trouble qui parle d’ennui et de réclusion dans une principauté semi-totalitaire — a marqué une inflexion plus ambitieuse dans l’inspiration de P. Cameron. Il n’est pas certain que ce livre assez peu aimable ait amélioré l’audience de l’auteur, avec son personnage principal subtilement antipathique et son écriture monocorde. Les nouvelles réunies dans le recueil Au beau milieu des choses (The Half You Don’t Know, 1997) s’accordent au principal avec la veine réaliste teintée d’humour des premiers romans. N’ayant pas lu Là-bas (The City of Your Final Destination, 2002), je ne saurais inscrire cet ouvrage dans cette trajectoire.
En revanche, je viens de terminer son dernier ouvrage publié, Someday, This Pain Will Be Useful To You (2007). Et c’est de loin son livre le plus réussi à mes yeux. Je l’ai dévoré en trois jours dans une sorte d’euphorie tranquille. Comme c’est le premier que je lis en anglais, j’ai assez peu d’éléments de comparaison du point de vue de l’écriture. Je n’ai aucune envie de me livrer à l’exercice scholastique consistant à comparer la manière de ce roman avec celui des précédents. Qu’il me suffise de dire que c’est un livre qui procure une jubilation permanente au genre de lecteur que je suis.
Pour la première fois, le personnage central (et narrateur) est un jeune homme de dix-huit ans, James Sveck. On pourrait traduire le titre par « Un jour, cette peine te servira à quelque chose ». C’est le genre de maxime dont le héros a été abreuvé par son entourage, pour lui faire passer la pilule d’une existence décevante. Fils d’un businessman stylé et d’une galeriste (divorcés, obviously), new-yorkais de la tête aux pieds, James a un problème majeur avec le monde, et principalement avec ses contemporains. D’une intelligence et d’une clarté d’esprit stupéfiantes, James n’arrive pas à supporter la médiocrité et les mascarades qu’on voudrait lui infliger. La seule personne qui trouve grâce à ses yeux est sa grand-mère, ancienne artiste de 80 ans passés, qu’il visite régulièrement et chez laquelle il va se réfugier quand son moral est vraiment bas.
L’essentiel du roman se passe durant l’été 2003, alors que James vient de sortir du lycée (high school), travaille dans la galerie d’art de sa mère (très peu fréquentée) et devrait en théorie entrer dans un college assez prestigieux (Brown). Mais voilà : il n’en a pas la moindre envie. Son unique désir serait d’acheter une vieille maison dans le Midwest et d’échapper à la mascarade des études. On suit également des épisodes remontant au printemps de la même année : visite de Washington parmi un groupe de brillants lycéens qui a fait dérailler le personnage et l’a conduit chez une psychothérapeute.
A woman appeared in the doorway. Although there was only me and the tuna sandwich lady, she looked around the room as if it were full of people and said, “James? James Sveck?”
“Yes” I said. I stood up and approached her.
She held out her hand and I shook it. It felt very cool and slender, “I’m Dr, Adler,” she said, “Why don’t you come with me?”
I followed her down a depressing hallway into a tiny windowless office that might have housed an accountant. […]
I must have looked as surprised as I felt when I entered her office, for Rowena Adler looked at the utilitarian clutter about her and said, “I’m sorry about this mess. I’m so used to it. I forget how it looks.” Then she sat down and said, “It’s nice to meet you, James.”
I said, “Thank you” as if she had paid me a compliment. I wasn’t about to say it was nice to meet her, too. I hate saying anything expected like that, that kind of dead, meaningless language.
“Why don’t you sit down there?” she said, indicating an uncomfortable-looking metal folding chair. It was the only other chair in the room, but she said it as if there were many and she had selected this one especially for me. She was sitting in a tweed-covered office chair on casters that was turned away from her desk. The room was so small our knees almost touched. She leaned back, ostensibly to be more comfortable, but I could tell it really to move away from me, “I usually see patients in my office downtown, but on Thursdays I can’t get away from here, and I wanted to see you as soon as I could.”
I didn’t like the way she called me a patient, or implied I was a patient, although since she was a doctor and I was consulting her I’m not sure what else I could be. A client sounded too businesslike, but she could have just said “people” but then I thought I was wrong to be offended: there is nothing shameful about being a patient, one does not bring sickness upon oneself, it is an unelected characteristic—cancer and tuberculosis are not indications of people’s character (I had read Susan Sontags Illness as Metaphor in my modem morals class last spring), but then I thought, Well, maybe with psychiatry it’s different, because if you’re manic-depressive or paranoid or sexually compulsive it is rather indicative of your character, or at least inextricably linked with your character, and these things must be bad, otherwise they would not be treated, so being a patient in these circumstances was an indication of some sort of personal failure or—
“So, James” I suddenly heard her saying, “what brings you here?”
This seemed a stupid question to me. If you go to a dentist you can say “I have a toothache” or you go into a jeweler’s and ask to have a new battery installed in your watch, but what could you possibly say to a psychiatrist?
“What brings me here?” I repeated the question, hoping she would rephrase itmore intelligibly.
“Yes.” She smiled, pointedly ignoring my tone. “What brings you here?”
“I suppose if I knew what brought me here, I wouldn’t be here”, I said.
“Where would you be?”
“I’m afraid I don’t know”’ I said.
“You’re afraid?”
I realized that she was one of those annoying people who take everything you say literarily. “I misspoke’ I said. “I’m not afraid, I just don’t know.” (p. 68-70)
Avec sa narration à la première personne, son héros en décalage, son humour, le livre a été immédiatement comparé avec L’Attrappe-Cœur de J.D. Salinger par la critique américaine. C’est comme s’il n’existait pas d’autre exemple de teen novel réussi ! Ce que James Sveck partage très certainement avec Holden Caulfield, c’est le pouvoir émotionnel : je n’ai pas l’habitude de m’attacher à un personnage de fiction. Celui-ci fait exception, un peu à la manière du Hal de Dance on My Grave d’Aidan Chambers. Peter Cameron en a fait un narrateur cultivé (il vénère Denton Welch — ce que je peux comprendre !), extrêmement ironique et en même temps traversé par une grande fêlure. Tout au long du roman, de rebuffade en bêtise, d’errements en tâtons, de dialogue de sourds avec la famille en moments de complicité, le lecteur fait face tout à la fois aux contradictions post-adolescentes du personnage et à son profond désarroi (lequel est très élégamment suggéré plutôt que dénoté).
Someday, This Pain Will Be Useful To You est aussi un roman satirique qui moque sans férocité les milieux « libéraux » (au sens américain) new-yorkais (mais aussi la province « crasse »). Le paradoxe de la retenue de James, de sa réticence foncière à socialiser, est d’autant plus puissant qu’il a grandi dans un univers on ne peut plus libre, aisé et open-minded : le directeur de la galerie de sa mère est un trentenaire gay et noir, sa sœur vit l’amour libre avec un sociolinguiste prénommé Rainer Maria (et marié par ailleurs), etc. Un à un plusieurs adultes demandent à James s’il est gay pour mieux le « comprendre » (en fait à chaque fois que le héros a un comportement bizarre). Son aversion pour l’idée d’entrer dans un college suscite une incompréhension totale, dessinant assez subtilement une norme sociale dans laquelle tout ce petit monde est enfermé. Même la grand-mère ne comprend pas :
She put milk in her coffee and stirred it and pushed the creamer and sugar toward me and then said, “What’s this all about? Are you thinking of not going to college, James?”
“Yes’ I said. “How did you know?”
“Perhaps I am clairvoyant after all” she said.
“Well, do you think I should go to college?”
“I suppose I’d have to know what you would do if you didn’t, I hardly see why what I thought would be of any interest to you.”
“Well, I am interested, I wouldn’t ask you if I weren’t.”
“Why don’t you want to go to college?”
She was the third person who had asked me that question in as many days, and I felt I was getting worse instead of better at answering it. My grandmother waited patiently for my answer. She pretended there were crumbs on the table that needed brushing off.
After a moment I said, “It’s hard for me to explain why I don’t want to go. All I can say is there’s nothing about going that appeals to me. I don’t want to be in that kind of social environment, I’ve been with people my own age all my life and I don’t really like them or seem to have much in common with them, and I feel that anything I want to know I can learn from reading books — basically that’s what you do in college anyway — and I feel I can do that on my own and not waste all that money on something I don’t think I need or want. I think I could do other things with the money that would be better for me than going to college.”
“Such as?” my grandmother asked.
I didn’tanswer because itwas suddenly clear to me, for a second or two, that part of this not wanting to go to college was simply a desire not to move forward, for I loved where I was at the moment, and felt that so surely and keenly: sitting there, in my grandmother’s kitchen, drinking her freshly percolated coffee from coffee cups and not from cardboard cups with sippy lids, sitting in her perfectly ordered kitchen with the back door open so a bit of a breeze moved through the house, and the electric clock above the sink humming quietly all night and all day, and the linoleum floor worn down from so many years of washing and scrubbing it was as smooth as leather, and my grandmother sitting across from me in her dress she had probably bought forty years ago and worn a thousand times since then, listening to me, seeming to accept me in a way that no one else did, and the safe summer Saturday occurring outside, all around us, the world not yet totally violated by stupidity and intolerance and hate. (p. 79-80)
Je rajouterai encore que la langue de l’auteur est d’une simplicité à proprement parler classique, ce qui figure assez bien l’esprit du personnage. Certains ont parlé de « antihéros » — ce que je trouve abusif. James est avant tout décalé. Sa compréhension instinctive et son refus de la banalité, des à-peu-près et du suivisme le tiennent à l’écart, mais c’est sans le moindre snobisme. Son tempérament le plus intime le contraint à faire de la rétention, au nom d’un besoin presque maniaque de ne pas trahir la pureté (de ses pensées ou sentiments). Ainsi embastillé, il n’est pourtant jamais pitoyable, bien au contraire, même si ses ennuis avec l’existence sont parfois touchants.
C’est un de ces livres qui pourraient aussi bien figurer dans une collection pour young adults que dans l’édition classique pour adultes (ce qui est le cas). J’ignore si une traduction est prévue. Je ne saurais le recommander avec assez d’enthousiasme à ceux qui peuvent le lire.