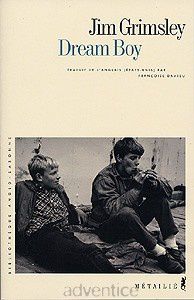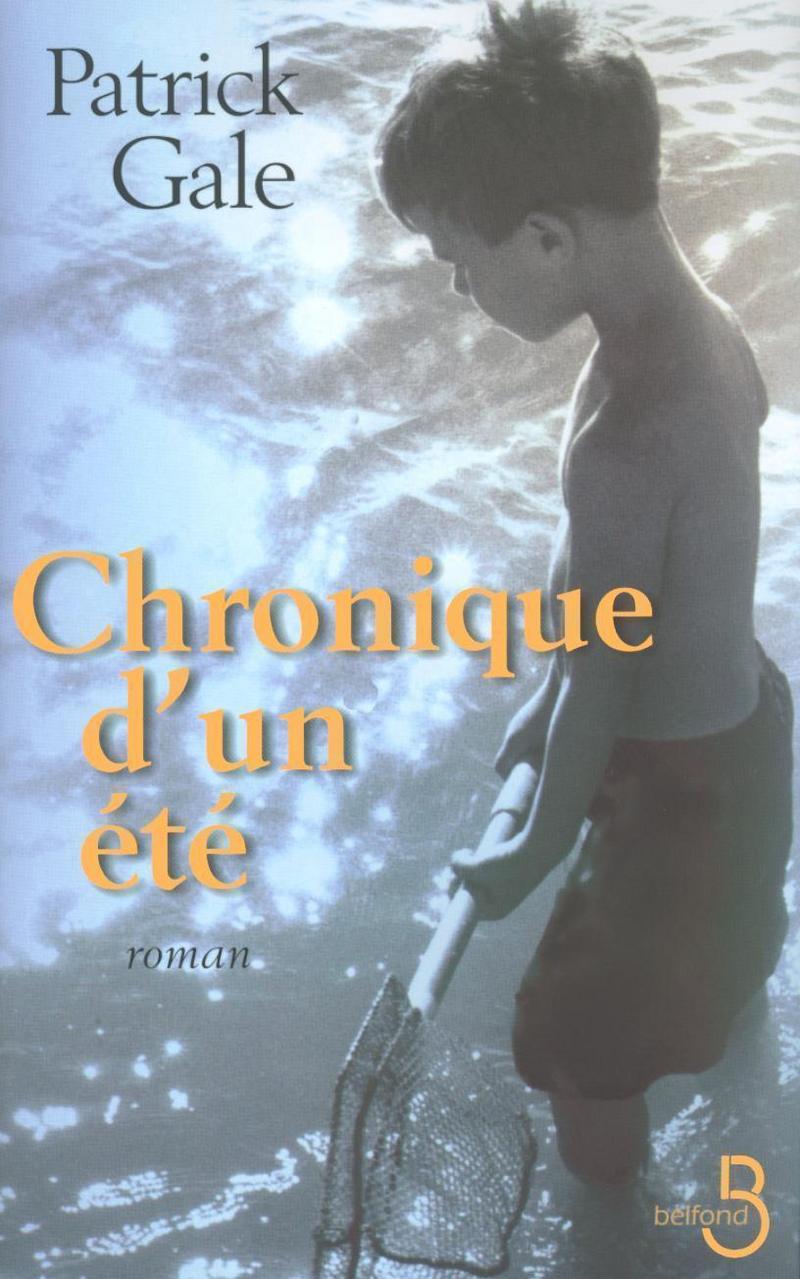La nouvelle est tombée la semaine dernière : « l'écrivain Tony Duvert a été retrouvé mort le mercredi 20 août à son domicile de Thoré la Rochette ». Détail macabre, le décès remontait à un mois. Ni suicide, ni assassinat. Après vingt ans de silence, c'est dans une nuit plus épaisse qu'il s'est évanoui.
La nouvelle est tombée la semaine dernière : « l'écrivain Tony Duvert a été retrouvé mort le mercredi 20 août à son domicile de Thoré la Rochette ». Détail macabre, le décès remontait à un mois. Ni suicide, ni assassinat. Après vingt ans de silence, c'est dans une nuit plus épaisse qu'il s'est évanoui.Il y a catharsis en littérature si la réalité pénible que peint l’écrivain est transfigurée par le bonheur de l’expression. Virus atténué égale vaccin. La beauté formelle saisit et extirpe la cause même de la souffrance que le thème de l’oeuvre avait ranimée.
Mais la beauté est perçue seulement à l’issue d’une éducation personnelle, et l’effet de catharsis n’est sensible qu’à celui qui a appris à lire. Tâche infinie.
Les autres gardent en eux leurs microbes, et se contentent d’un emplâtre sur l’abcès, ce cataplasme de litière pour chat qu’ils appellent un beau livre.
Tony Duvert a publié entre 1967 et 1979 une douzaine de romans, récits, fragments, auxquels il faudrait ajouter force articles dans diverses revues. Ses premiers livres ont été publiés sous forme de souscription, car son éditeur Jérôme Lindon redoutait une violente réaction sociale (voir à ce sujet l'article d'Anne Simonnin, « L'écrivain, l'éditeur et les mauvaises mœurs »). En 1973, Paysage de Fantaisie a obtenu le prix Médicis, ce qui rétrospectivement apparaît plutôt courageux de la part des jurés. Le livre, qui raconte la vie sauvage d'une troupe d'enfants dans un château aux airs de maison close, est l'un de ses plus aboutis.
 En 1978-1979, l'écrivain atteint un sommet d'activité : deux romans, dont son chef d'œuvre, L'Île atlantique, et deux magnifiques recueils de textes courts aux éditions Fata morgana. D'une certaine manière, le reflux est intervenu immédiatement : la décennie qui suit verra seulement la publication de deux pamphlets et d'un roman assez médiocre, Un anneau d'argent à l'oreille. Et depuis l'Abécédaire malveillant de 1989, plus rien...
En 1978-1979, l'écrivain atteint un sommet d'activité : deux romans, dont son chef d'œuvre, L'Île atlantique, et deux magnifiques recueils de textes courts aux éditions Fata morgana. D'une certaine manière, le reflux est intervenu immédiatement : la décennie qui suit verra seulement la publication de deux pamphlets et d'un roman assez médiocre, Un anneau d'argent à l'oreille. Et depuis l'Abécédaire malveillant de 1989, plus rien...Il est assez tentant de lire ce repli comme un effet de la réprobation croissante dans notre société à l'égard d'un auteur qui fut le chantre des relations intimes entre enfants et adultes. C'est possible, et le ton assez bilieux de L'Enfant au masculin (1980) et de l'Abécédaire pourrait encourager cette lecture.
Un moyen de montrer l’imposture des « littéraires », critiques, écrivains, professeurs, glosateurs, découvreurs, cultureux de tout panier, de tout salon, de tout commerce, c’est de les prendre à la lettre et d’agir selon ce qu’ils prêchent à la Littérature d’être et disent qu’elle a été. Apprendre leurs décalogues épineux, mener une carrière aux règles arides, une vie exigeante, méditer les grands modèles, produire un art à leur exemple, être résolument seul, imprudent, neuf, s’égarer, déranger, être vrai : bref, se plier aux valeurs les plus rudes que ces gens aient enseignées aux jeunes, préconisées à longueur de thèses, de manuels scolaires, d’articles et de congrès, jetées à la figure des gribouilleurs, des infatués, des mercantis.
Ce choix devrait-il vous marginaliser ? Évidemment non : il vous situe au centre même de la tradition. Et tel fut mon effort depuis vingt ans et plus : or j’en fais un étrange bilan. Je crains bien d’être l’un des rares auteurs que ces cultureux conchient de rage, omettent avec obstination, diffament avec joie, pillent d’un air absent, traitent en débutant bizarre, enfant terrible, talent fourvoyé, censurent, éloignent, affament, plagient en l’insultant et enterrent comme on écrase un mégot. Scandale à la messe un croyant est venu. Sortez-le!
Abécédaire malveillant, Minuit, 1989, p. 110-11.

trois garçons traversent sur une barque verte et noire un bras de la rivière qui s’élargit avant le grand bois et enserre une île que couvrent des châtaigniers et des fourrés épais le garçon blond et le plus jeune enfant ne sont pas du village leurs traits fins et leurs façons gracieuses prouvent qu’ils appartiennent sans doute à l’institution les deux plus grands ont environ douze ans et sont en maillot de bain aux couleurs gaies le troisième a une dizaine d’années son torse est nu il porte un short en velours noir qui semble plutôt l’élégante culotte courte d’un petit costume elle lui tombe aux hanches faute de ceinture et la bande élastique blanche du slip en déborde irrégulièrement sur les reins
Paysage de fantaisie, Minuit, 1973, p. 47.
Je voulais parler des oiseaux, mais ce n’est plus l’heure. Au printemps on a vu des cigognes; elles étaient grises et maigres, pareilles aux branches mortes des nids qu’elles bâtissent sur certains remparts, loin vers le sud. Plus tard, elles ont étiré leurs ailes tristes et, lentement, avec un vieux bruit d’éventail disjoint, elles ont pris leur essor.
Il y a eu dans la ville un temps de carême et j’ai commencé à écrire. C’est l’hiver d’un monde sans saisons ; mes amis me désertent ; vivre est plus lourd. Les journées de soleil s’écoulent et on n’en fête aucune. Puis, au crépuscule, l’existence peut reprendre. Les mangeurs occupent déjà les bancs des gargotes en plein air, et reçoivent les bols où se verse la soupe aux pois chiches. C’est une purée liquide, pimentée, mêlée de lentilles, acidulée de tomates, où nagent des fèves et du vermicelle ; elle sent le grain torréfié, elle est bonne, farineuse et forte, elle brûle. Je suis dans une maison qui m’intimide. Une veuve et sa fille sont assises à ma gauche, presque par terre, sur une paillasse à fleurs. Je me tiens au bord d’un sommier de fer qu’une autre paillasse change en divan; les deux femmes s’adossent à l’arête d’un lit semblable ; sur des tabourets, les fils aînés complètent le cercle. Une table basse est au milieu de nous. La mère a posé la marmite de soupe près d’elle, dans l’angle du mur. Jambes en tailleur, robe et tablier relevés aux genoux, les mamelles grosses, la face plate et carrée, la peau onctueuse de blancheur, la bouche et l’oeil étroits, elle aspire sa soupe dans une petite louche en bois et me jette des regards brefs, un peu méfiants, un peu dédaigneux, un peu aimables. Je me sens l’un de ces vieux chiens raides à qui les femmes donnent un câlin parce que c’est le protégé de leur commère. Je fais l’amour avec l’un de ses grands fils, elle le sait peut-être ; et les sourires convenus qui tirent rides et fossettes dans la graisse de sa figure font paraître plus froids ses petits yeux durs.
Journal d'un innocent, 1976, p. 7-8.
 Un an après, L'Île atlantique est une sorte d'antithèse du roman précédent (ou le revers de la médaille ?), tableau violemment désenchanté de la guerre familiale, dans lequel le seul apprentissage possible est celui d'une aliénation. Moderne Rousseau, Tony Duvert explore les chemins du dressage qui transforme la « progéniture » humaine en une meute cupide, calculatrice et désenchantée. Les adolescents du roman, les Marc Guillard, Bertrand Seignelet, Hervé Pélisson, sont déjà des créatures veules et piégées par le système, y compris dans leurs révoltes individualistes.
Un an après, L'Île atlantique est une sorte d'antithèse du roman précédent (ou le revers de la médaille ?), tableau violemment désenchanté de la guerre familiale, dans lequel le seul apprentissage possible est celui d'une aliénation. Moderne Rousseau, Tony Duvert explore les chemins du dressage qui transforme la « progéniture » humaine en une meute cupide, calculatrice et désenchantée. Les adolescents du roman, les Marc Guillard, Bertrand Seignelet, Hervé Pélisson, sont déjà des créatures veules et piégées par le système, y compris dans leurs révoltes individualistes.
Madame Théret n’était aucunement jalouse des femmes de ce milieu, pourtant si supérieur au sien. Elle n’enviait que les continentales. Qu’une touriste chic, en pantalon, bronzée, longue, lunettes de soleil remontées sur le front, pacotilles ruineuses, maigre comme une chèvre et la voix comme un aéroport, entre dans la boutique et madame Théret chavirait de rage. Elle qu’on jugeait belle, élégante, juste assez replète, elle n’était plus qu’un petit pot, une commère, une concierge bas du cul, une bonniche mal ficelée et mal attifée, devant ces prétentieuses de Paris. Des femmes qui réclamaient des produits impossibles sur un ton protecteur, vous souriaient comme à une attardée et n’achetaient presque rien. Ça ne les empêchait pas de vous empoisonner pendant une heure, avec leur genre, à sucer leurs lunettes pour vous cracher dessus.
Belle et élégante, au contraire, demeurait madame Théret devant les Salorde et toutes leurs semblables de l’île, qu’elle accueillait courtoisement.
Madame Salorde baisse les yeux vers sa petite-fille :
— Yolande voyons ! Ne mets pas tes doigts sur ce comptoir tu vas te salir ma chérie.
« C’est ça fous-les toi au cul ce sera plus propre », pense madame Théret, en veine d’ironie.
L’enfant préfère se toucher le nez. Madame Salorde fait la cliente avec talent. Elle ne lésine pas. Louise Théret lui donne très bien la réplique. Hélas non, elle n’a pas de vinaigre de mangues. Ni même de vinaigre de framboises ? Ni même de framboises. Cela se prépare chez soi, madame. Certes, madame, mais j’aurais souhaité, euh. Désolée, madame.
Yolande a rêveusement investi une de ses narines et elle l’occupe du pouce, en béant sur les rayons poussiéreux de chêne noirci. Tant de boîtes coloriées! Tant de bouteilles! Tant de beaucoup, non, de bocaux ! Tant de choses, de choses. La narine, bien grattée, s’humecte peu à peu.
— Je t’ai pourtant défendu Yolande ma chérie. À ton age, voyons!
La fillette fronce les sourcils : quelle interdiction est-ce, déjà ? Ah oui, le nez. Zut pour le nez. Elle se fait indolemment essuyer le doigt coupable. Madame Théret, du haut du comptoir, lui grimace un sourire. Ce ne sont pas ses filles à elles qui seraient aussi moches et gourdes. Des trésors, les petites Théret.
— Et vos trésors? dit madame Salorde. Je ne les vois plus ! Nous habitons, oh ! si loin !
— Elles vont bien, mais je vous remercie ! dit coquettement madame Théret. Elles sont un peu plus grandes que cet amour, bien sûr, neuf et dix ans, bien sûr.
— Bien sûr, oui oui, oh ! oui ! Ça pousse si vite, si vite, oh, oui !
— Oh oui, oh, oui ! Ça pousse vite ! Ça pousse à une allure !...
— Oh, oui, à une allure ! C’est le mot ! On ne les voit plus grandir ! À peine elles naissent, et les voilà déjà mariées
— Oh oui, oh ! A peine ! approuve Louise Théret.
— Je sais pas, de votre temps, mais de mon temps, on ne grandissait pas si vite ! dit madame Salorde. On restait plus longtemps petite fille, il me semble ! Tenez votre fils est-ce qu’on ne dirait pas déjà un grand garçon ? Ah! Et pourtant il n’a que...
— Treize ans, complète madame Théret. Eh oui ça pousse, ça pousse. À peine ils sont là et on ne les voit plus.
— Oui, oui, oh! Ne m’en parlez pas ! ... A une allure
— Oh, ne m’en parlez pas, c’est affolant! Enfin... Vous l’aurez bien encore quelques années cet amour!
— Oui, oui, oh! oui! Tout de même! Cette chérie ! Ça ne pousse quand même pas si vite que ça
— Oui, oui, oh non ! Il ne faudrait quand même pas exagérer ! Ça ne pousse pas si vite, oh non ! ... On a le temps de les voir les années !
— Oh ! oui, on a le temps ! oh oui, hélas, oh ! Comme ça passe
Elles émettent des soupirs protecteurs, nostalgiques et tendres.
Madame Salorde achète des confitures de gingembre, de bergamote, de cédrat, un flacon de marjolaine, cinq grammes de safran en filaments et deux onces de thé Mao Feng cha.
— Oui, oh ! Succulent, si fin, si léger, si délicat, oh ! Il n’y a que chez vous qu’on le trouve ! Rien que pour cela d’ailleurs ! Mais toute votre boutique est... Oh cet arôme !
« Je te crois qu’elle sent meilleur que la tienne ma boutique », pense sarcastiquement madame Théret. Elle jette à la dérobée des regards carnassiers à la vieille madame Salorde, baisse les yeux avec pudeur, murmure « un thé très rare, il est très rare », tuerait un chat à coups de talons s’il y en avait un sous le comptoir.
L'Île atlantique, Minuit, 1979, p. 70-72.
À l'image de ses inspirateurs, Duvert a peuplé son Île de personnages aux noms inoubliables : les Guillard, Théret, Seignelet, Grandieu, Salorde, Boitard, Glairat, Roquin, Pélisson, Gassé, Viaud, etc., à la fois on ne peut plus français et en même temps malicieux. Les quelques patronymes qui échappent à la signification parodique sont ceux des personnages un peu neutres (ou positifs) comme Mme Lescot et la lointaine « doctoresse Ambreuse ». Tous les personnages ne sont pas également présents dans la narration, mais presque tous ont des noms qui tintent, ainsi Claire Fouilloux, la jeune prostituée écervelée, le « président » Gassé, parangon de notable, Raymonde Seignelet (inutile que je reparle d'elle !), François-Xavier Boîtard et sa concupiscence pour les oreilles de Camille Gassé...
Quant à ce réalisme extrême qui me semble égal à celui de Tolstoï par sa puissance d'évocation, il est distillé dans certaines phrases et des fragments de dialogue, à concurrence des autres veines du roman (les aspect satiriques, notamment). Pour en donner une idée, j'ai choisi délibérément un passage relativement peu virtuose en apparence, et pas spécialement méchant. Il me semble néanmoins donner une présence intense au personnage de Mme Lescot, tenancière d'un café-restaurant.
Madame Lescot se demande pourquoi Joachim n’est pas venu l’embrasser : d’habitude il est couché à cette heure-ci. Il n’a quand même pas veillé jusqu’à onze heures et plus ! Le coquin, ou il aura encore relu sa pile d’illustrés ! Il lit, il lit, il lit tellement vite que parfois il saute tout le texte, ne suit que les images et ne comprend plus l’histoire. Alors il apporte l’illustré à sa maman pour qu’elle lui explique.
— Ma poule, mon poussin, eh bien tu ne sais plus lire mon chéri ? reproche, toute bonne, madame Lescot. Tu as déjà oublié comment on lit ?... Et voyez-moi ce petit âne qui ne sait rien, rien, rien lire, même pas dans ses illustrés, le petit, petit âne ! ... que je vais embrasser le chéri !
— Meuh ! Meumeu ! ... fait complaisamment Joachim.
Madame Lescot ouvre des moules sur le feu. Un client, de l’autre côté du comptoir, siffle des rhums debout et lui parle de croustades aux fruits de mer. Qu’a-t-il donc à aimer ces saletés ? pense Yvonne Lescot. Elle n’ose rien en dire. Les buveurs, ça a sa petite idée dans un coin et ça ne la lâche plus. Pas la peine de répondre, de discuter.
— Et attention ! Pas des soi-disant quenelles de ceci cela ! Attention ! C’est pas ça que je veux ! On m’a pas comme ça moi ! Pour bouffer de la farine moi j’aime mieux bouffer du pain ! Alors là attention ! ... Non mais c’est pas vrai ?
— Oui, oui, ah oui le pain, dit machinalement madame Lescot. Elle ne peut pas quitter ses moules, qu’on mange ici presque crues mais très chaudes : il faut l’oeil. Elle ira voir après si Joachim est couché. Et une crêpe nature pour madame Bignon (une soularde, entre parenthèses, brave femme, ça n’empêche pas, et pas malheureuse avec la rente de son viager : c’est plutôt qu’elle s’ennuie), non, à la confiture : ah, Yvonne Lescot ne sait plus.
— À quoi, déjà votre crêpe madame Bignon? crie-t-elle vers un coin enfumé de la salle.
— À ce que tu veux ma petite! répond madame Bignon. Elle a un ton de harengère mais une voix flûtée, roucoulée, aux notes très rondes : elle a dû apprendre le chant, jadis, à l’église ; et pousser la chansonnette sentimentale dans les noces, où son gros organe suraigu, son vibrato surprenaient. Ces mémères pleines de romances, leur énorme poitrine bombée comme une gorge de colombe, remuaient un sentiment filial chez madame Lescot.
Elle pensa qu’elle pourrait mettre une télévision pour les clients du soir ; ce serait gentil, s’ils étaient tous roucoulants, maternels et solides comme cette vieille madame Bignon. Et peut-être ils baisseraient un peu la voix. Madame Lescot n’était pas hostile à un certain vacarme, cependant; son café ne lui plaisait jamais tant qu’aux heures d’affluence extrême, quand s’embrouillaient les conversations, les rires, les appels, les chocs de verres, les effluves alcoolisés, les grincements de chaises qu’on tire, de tables qu’on rapproche : et ce brouhaha, mêlé aux fumées bleues des cigarettes, étirait à travers la salle des longs fils souples, nouait des filets, des hamacs, d’étranges ponts suspendus où se mouvait madame Lescot, oscillante et affable, dans les vapeurs.
— Et ils vous bourrent ça de champignons de Paris ! disait l’ivrogne à croustade. Non mais ça pousse dans la mer les champignons dites-moi ?... Dans la mer cette blague !
— Non non vous pensez! murmura madame Lescot, qui répondit plus fort à madame Bignon :
— Alors je vous la fais attendre deux petites minutes, je suis inquiète, je vais voir mon canard.
Avant, elle servit ses moules : et elle débouchait du blanc supérieur quand Joachim apparut dans la salle. Il était habillé, avec sa nouvelle culotte courte en velours bleu et son chandail rouge géranium, à petites étoiles jaune canari en forme de cristaux de neige. Madame Lescot, savante, tricotait ces jacquards aux heures creuses : surtout pour ne pas trop manger, car l’oisiveté lui donnait des fringales, elle se jugeait déjà un peu boulotte, elle n’avait pas peur d’un petit verre non plus, alors oui le tricot, les étoiles.
— Oh poussin ! gémit Yvonne Lescot comme si l’enfant était blessé, mais tu fais pas encore dodo ? Oh, chéri !
Joachim Lescot ne semblait pas le moins du monde ensommeillé ; la bouche riante, les pommettes pointues, les yeux en fleurs, c’était un vrai angelot, frais comme le matin : madame Lescot eut ce sentiment. Elle se demandait ce qui avait rendu son fils si joli, quand celui-ci commença un récit volubile où il était question de batailles, de pouilleux, de polissons, de pognon.
L'Île atlantique, Minuit, 1979, p. 127-130.
Pendant les longues flemmes qu’elle tirait, l’après-midi, Raymonde Seignelet avait ses rites, qui étaient invariables, et qu’avaient découverts peu à peu ses enfants les moins impressionnables, Bertrand et surtout Jean- Baptiste : ils en ricanaient à loisir, et ils assouvissaient ou entretenaient leur haine des époux Seignelet en épiant et en collectionnant leurs ridicules, leurs saletés, leurs énormités. Même Bertrand, à ces exercices hygiéniques, se retrouvait un peu d’esprit.
Le singulier est que madame Seignelet ne dissimulait guère. Il n’y avait pas grand-chose à surprendre, et elle affichait jusqu’à ses douteuses gourmandises ou son discret penchant à l’ivrognerie (ou plutôt au biberonnage : elle aimait siffler du vin, des apéritifs sucrés, muscats, vermouths, par gorgées isolées, pour s’entretenir, mais elle ne se soûlait jamais, gueule avide et cervelle glacée). Elle annonçait, d’un glapissement bêtasse et geignard, la raison qui la forçait à s’infliger telle ou telle chose qui, pour tout autre, auraient été des gâteries mais qui n’étaient pour elle que des souffrances, des contraintes, des calvaires de plus. Ainsi, lorsque Jean-Baptiste ou Bertrand « découvraient » un vice de madame Seignelet, c’était simplement que, soudain, les récriminations de leur mère ne les abusaient plus : ils se bouchaient les oreilles, ils voyaient ce qu’il y avait à voir, ils jaunissaient de révolte, de mépris. Comment ! C’était cette vieille vache écoeurante, menteuse, hargneuse, infantile, malpropre, qui les avait malmenés, qui les tyrannisait encore ? Incroyable ! Et ils se dépeignaient les travers de madame Seignelet, parodiaient, soupçonnaient, supputaient, inventaient d’autres tares, comme des potaches qui se vengent d’un pion odieux ou d’un prof ubuesque.
Dominique et Philippe n’avaient pas cette santé. Ils prenaient au mot leur père et leur mère. Ils ne se seraient pas permis un regard criminel à la Jean-Baptiste, une ironie ou une mine à double sens pendant les repas, un doute sur la véracité des discours parentaux, la perfection des us et coutumes seignelesques, la légitimité des engueulades, la respectabilité des humeurs de chien, l’humanité profonde des gifles, la noblesse grave des vachardises adultes, le sublime sacrifice de papa, l’abnégation bouleversante de maman. Et quand Philippe s’approchait d’une vitre, regardait dehors, et que sa mère ânonnait aussitôt une interdiction hurlante, comme : « Touche pas aux carreaux tu vas encore tout salir ! On voit que c’est pas toi qui les fais ! Tu t’en fous du travail de ta mère hein ! Ben pas moi ! Et qu’est-ce que t’as besoin de regarder par la fenêtre hein avec tes mains sales que tu vas fiche partout ? » il croyait sincèrement qu’il était infernal et que sa mère était persécutée.
La malheureuse usait sa vie, en effet, à réparer les saletés que tout le monde s’ingéniait à faire; chaque objet, chaque centimètre du logis était sacralisé, presque tabou : il était le travail de maman. L’employer, ou seulement être là, c’était détruire son oeuvre. Raymonde Seignelet excellait dans l’art de vous culpabiliser d’exister. Votre respiration même lui était à charge. Ne l’obligerait-on pas à se déranger pour ouvrir et aérer ? Que les enfants nettoient quelque chose : madame Seignelet, pour tout remerciement, grinçait qu’ils avaient sali le balai, l’éponge, mal vidé l’aspirateur, rangé la vaisselle n’importe où, laissé un évier dégoûtant.
L'Île atlantique, Minuit, 1979, p. 115-116.
SILENCE
Des écrivains cheminent vers le silence, renoncent à s’exprimer, à communiquer. Jugent-ils trop mensonger de dire, de croire, de faire croire? Tout progrès intellectuel vous rend plus apte à créer, mais plus réticent à le faire.
On rejoint l’abstention des bons esprits qui n’ont rien mis au monde.
Abécédaire malveillant, Minuit, 1989, p. 112-113.
Sélection bibliographique (certains ouvrages sont très difficiles à trouver aujourd'hui)
Récidive, roman, Minuit, 1967.
Paysage de fantaisie, roman, Minuit, 1973. (Longtemps disponible en « folio ».)
Journal d'un innocent, récit, Minuit, 1976.
Quand mourut Jonathan, roman, Minuit, 1978.
District, récits, Fata Morgana, 1978. (Ses plus belles proses ?)
Les Petits métiers, récits, Fata Morgana, 1978. (On pense à Michaux dans ce bestiaire de métiers imaginaires.)
L'Île atlantique, roman, Minuit, 1979. (Réédité en format de poche par Le Seuil en « Points roman » puis dans la collection « Double » chez Minuit.)
Abécédaire malveillant, aphorismes, Minuit, 1989.
Sur Duvert :
Anne Simonnin, « L'écrivain, l'éditeur et les mauvaises mœurs », dans Damamme (D.), Gobille (B.), Matonti (F.) et Pudal (B.), dir., Mai-Juin 68, Paris, éditions de l'atelier, 2008, p. 411-425.
Note postérieure (mars 2016) : l'écrivain Gilles Sebhan a consacré deux livres fort respectables à Tony Duvert, l'un en 2010 (Tony Duvert, l'enfant silencieux, Denoël) et l'autre en 2015 (Retour à Duvert, Le Dilettante). Le premier était une méditation assez personnelle, à une époque où très peu d'informations étaient disponibles. Par suite, des particuliers lui ont ouvert leurs archives (plus ou moins), de sorte que le deuxième livre est davantage la présentation de fonds documentaires, en particulier de correspondances, en même temps qu'une mise à jour de l'information sur la vie de l'écrivain. J'avoue que plus j'en apprends et moins j'ai envie d'en savoir davantage. La vie de Duvert a été particulièrement sauvage, précaire et isolée. Resteront les livres, l'art.


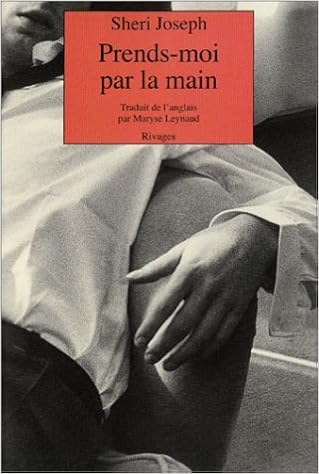
 Yves Navarre, Le Jardin d’acclimatation
Yves Navarre, Le Jardin d’acclimatation