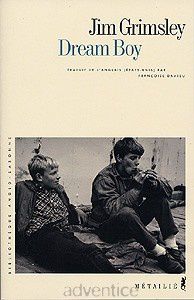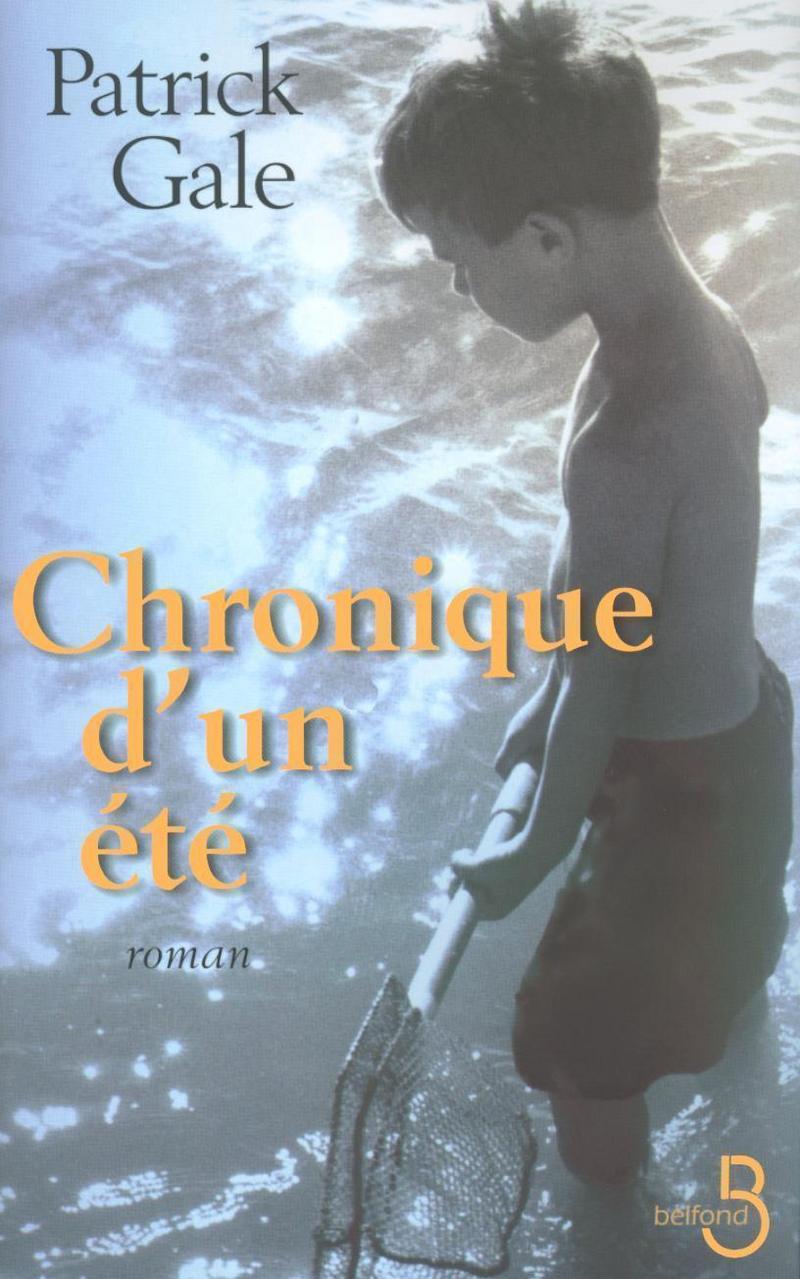Erwin Mortier, Les dix doigts des jours, Fayard, « Littérature étrangère », 2007.
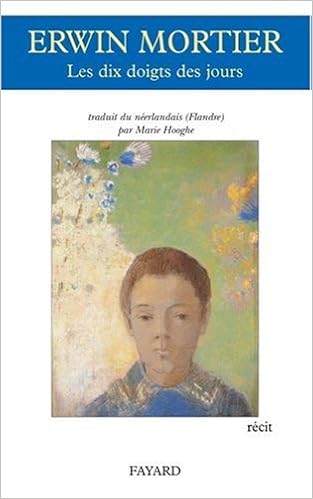 Les dix doigts des jours est paru en français en mai 2007. Je l’ai lu presque immédiatement, car j’attends chaque nouveau livre d’Erwin Mortier avec impatience. C’est un court texte (106 pages) désigné comme « récit » et non comme « roman ». On peut lire un peu partout que les trois premiers romans de l’auteur — Marcel (1999), Ma deuxième peau (Mijn Tweede Huid, 2000) et Temps de pose (Sluitertijd, 2002) — forment une « trilogie de la mémoire ». Pourtant, Alles Dagen Samen (2004) ne diffère pas fondamentalement des précédents, sinon qu’il est plus court et que le personnage central n’a pas de prénom avant la page 101. Pour le reste, il y a un net continuum d’inspiration.
Les dix doigts des jours est paru en français en mai 2007. Je l’ai lu presque immédiatement, car j’attends chaque nouveau livre d’Erwin Mortier avec impatience. C’est un court texte (106 pages) désigné comme « récit » et non comme « roman ». On peut lire un peu partout que les trois premiers romans de l’auteur — Marcel (1999), Ma deuxième peau (Mijn Tweede Huid, 2000) et Temps de pose (Sluitertijd, 2002) — forment une « trilogie de la mémoire ». Pourtant, Alles Dagen Samen (2004) ne diffère pas fondamentalement des précédents, sinon qu’il est plus court et que le personnage central n’a pas de prénom avant la page 101. Pour le reste, il y a un net continuum d’inspiration.
J’ai longtemps différé la rédaction de ce compte rendu. Il se trouve qu’Erwin Mortier est sans doute l’écrivain vivant (et en activité) que j’admire le plus aujourd’hui. Il se trouve aussi que nous nous écrivons de temps en temps et qu’il sait l’importance qu’il a à mes yeux. En somme, écrire sur l’un de ses livres implique de me sentir à la hauteur des circonstances. J’ai voulu aussi me donner le temps de relire Les Dix Doigts des Jours pour en avoir une vision aussi détaillée que possible. En outre, c’est un très grand texte de prose poétique, dont je voudrais donner à lire quelques passages, lesquels je voulais choisir avec soin.
Dans le monde néerlandophone, Erwin Mortier est déjà reconnu comme un grand. Marcel s’est vendu à plus de 100 000 exemplaires — ce qui est considérable pour ce « marché » linguistique. En France, il a la chance d’avoir une excellente et fidèle traductrice, Marie Hooghe, et un éditeur qui a fait le pari de la durée. En revanche, malgré le soutien de quelques organes de presse fidèles (Libération, Le matricule des anges), il demeure un auteur confidentiel. Il faut dire que sa conception du métier d’écrivain est en décalage complet par rapport à l’air du temps. Ce dernier privilégie la sécheresse stylistique et met en avant les bonnes histoires. Or les textes d’Erwin Mortier sont tout le contraire : des pièces d’orfèvrerie dans lesquelles chaque mot compte, où les métaphores étincellent, où la subtilité est partout. Ce n’est pourtant pas non plus un esthète évanescent. Il sait tout faire : des dialogues à la Sarraute, de la satire, du burlesque, un monologue, un tableau flamand, etc. C’est un écrivain complet, dont les deux premiers romans sont aussi on ne peut plus romanesques. Néanmoins, c’est avant tout un poète. Et Les dix doigts des jours manifeste plus encore que les livres précédents cet immense talent poétique.
N’étant pas néerlandophone, je me suis demandé si le titre original ne signifiait pas quelque chose comme « tous les jours se ressemblent ». Mais je n’ai pas le dictionnaire qui me permettrait de répondre à cette interrogation. En tout cas, le titre français renvoie pour sa part à l’état de conscience du personnage sur lequel est focalisé le récit : un petit garçon qui doit avoir dans les trois-quatre ans et qui, justement, ne sait pas encore compter plus que les doigts de la main. Son rapport à la parole et aux mots est plus compliqué :
Car les mots ne se montrent pas encore à lui. Il ne peut boire qu’à petites gorgées à leurs coupes.
« On ne peut pas dire qu’il a la langue bien pendue, dit, maman. S’il tient quelque chose de son père... Mais Dieu sait tout ce qui mijote dans cette petite caboche. »
Sa voix tourne en rond et se rembobine d’elle-même quand elle est au bout de la chanson, elle tapote des touches et frappe des cymbales. Elles croient qu’elles parlent, maman, grand-maman, tante Cactus, mais elles sont seulement, comme dit parfois papa, des grandes machines à trompette où il n’y a pas de bouton pour couper le son quand la mélodie ne vous plaît plus. (p. 21-22)
Avant, les mots étaient doux et duveteux, des petites graines aériennes, accrochées à des petits parachutes que le vent soufflait en nuages au-dessus des mottes de gazon, et plus haut encore, jusqu’aux fenêtres dans les peupliers où habitent les corneilles.
Les mots le firent éternuer ce matin, quand maman ouvrit la porte, la terre sentait si fort la terre sous ses semelles, si fort et si pleine de poussière qu’il tomba en morceaux dans sa tête, dut arrêter de babiller et reprendre son souffle. (p. 22-23)
Ce petit garçon porte le point de vue du récit, même s’il n’en est pas à proprement parler le narrateur (sauf épisodiquement, d’une certaine manière). Il est le témoin oculaire et la surface sensible sur laquelle se dépose la tragicomédie familiale. Bien plus jeune que le narrateur de Marcel ou que Joris dans Temps de pose, il rappelle Anton Callewijn dans la première partie de Ma deuxième peau. Le cadre est toujours le même : une famille de la Flandre rurale, où cohabitent plusieurs générations. Au moins quatre ici, même si Erwin Mortier a maintenu les filiations dans un état assez brumeux. Bien entendu, d’innombrables notations ne pourraient être le fait d’un tout petit garçon, mais l’auteur s’est tout de même amusé à épouser régulièrement la compréhension de son personnage, notamment pour donner à certaines scènes une résonance surréaliste ou burlesque. Ce sont d’ailleurs souvent des passages à la première personne du singulier :
Quand papa vient m’éveiller, je rêve de grands papillons de nuit dans la haie de troènes. Ils frétillent sur le drap quand je m’assieds et frotte les fils de mes yeux.
Il me soulève et me prend dans ses bras. Je pose mon cou sur l’arrondi de sa nuque et me laisse retomber par-dessus ses épaules pour compter le bord de chaque marche pendant que nous descendons. Il y en a dix et sept.
Quand nous arrivons en bas, je crie « Bravo ». Je veux taper dans mes mains, mais papa attrape mes doigts dans son poing.
Autour du lit en bas, les gens rient dans leur barbe.
Arrière-grand-père réfléchit sérieusement, les couvertures sont tirées jusque sous son menton. Ses fausses dents, il les a mises dans un verre sur la tablette de la fenêtre, ainsi il peut rire sans se fatiguer pendant qu’il meurt.
« Chuut », dit papa.
Arrière-grand-père se redresse. Regarde autour de lui avec des yeux qui n’ont encore jamais été aussi grands.
« Tous ces gens, dit-il. Tous ces gens », et il retombe sur les draps.
Les gens hoquètent de rire.
Toi aussi, maman. (p. 53-54)
Alles Dagen Samen : quelques jours d’un été ordinaire, mais qui ne l’est pas tant que ça. Le petit garçon est en convalescence après une longue maladie pulmonaire. L’arrière-grand-père décline et meurt. La famille accourt, y compris « les Français ». Le récit s’ouvre et se clôt sur une scène de sieste au soleil, Marcus et sa mère étendus sur une couverture. Dans cette boucle de temps, à d’autres semblable et en même temps différente, l’enfant apprivoise les mots et la mort (qui reste néanmoins mystérieuse).
« Allons, dis calinette bobinette balancette maminette », demande Maman.
Mais il dit : « Être-mort, maman, être-mort. »
Elle se redresse, s’assied.
Se tourne vers lui.
Prend son menton dans sa main.
Le regarde dans les yeux.
Elle s’allonge de nouveau par terre. Avec ses mains sur son ventre.
« Voilà, dit-elle. Maintenant, je suis morte, Marcus. C’est bien ?
- Marcus, répète-t-il, Marcus. » (p. 103)
Et un peu plus loin :
« Moi aussi être-mort, dit-il.
- Bon, dit Maman, mais sans bruit », et les petites autos glissent un peu dans son cou. (p. 105)
Les dix doigts des jours a cette façon calme, matter of fact, des petits enfants, de figurer les raccords et les divorces entre le monde et les mots. Par moments, les jeux de Marcus à la frontière de la parole et du sommeil sont à la limite de la verbigération. De celle-ci à la poésie, la frontière est poreuse :
Parfois, au milieu d’un mot, ma tête tombe sur l’oreiller.
Seuls les mots les plus difficiles sont assez forts pour repousser le sommeil de mes yeux.
Vase insigne de dévotion.
Reine conçue sans le péché originel.
Mère des Martyrs.
Ils rampent hors de ma bouche. Ils crissent sur ma lèvre supérieure. Fourmillent dans mes narines, vers ma tête.
Fourmi ardente.
Refuge des malades.
Rose mystique.
Ils volent çà et là, chargés de pollen. Se déplacent en caravane avec des brindilles et des cailloux, avec des graines, des chenilles, des mouches, sur mes jambes, vers le petit creux de mon ventre.
J’entends frémir des élytres, des ailes de verre, à moitié ouvertes et se fendant déjà. […]
Les mots chassent le sang vers mes tempes, figent ma cage thoracique, l’après-midi quand je joue aux petites autos pendant que sur le sofa, maman, le sommeil joue dans les bouclettes de ta tête qui chavire.
Ils bouillonnent comme un acide dans mon oesophage, forcent mes mâchoires, font taper mes pieds. Par terre, les petites autos filent dans tous les sens, et je crie:« Maman! Ça se bat dans ma tête... »
Le sommeil s’accroupit sur ton ventre et pose ses doigts sur ta nuque.
« Ça se bat ? »Tu ris, les yeux fermés. « Eh bien, laisse-les se battre, mon chou... » (p. 51-52)
La langue d’Erwin Mortier, pour autant que la traduction nous l’indique, est d’une incroyable souplesse, changeant de registre avec une aisance gracieuse, du poétique au prosaïque, du sublime au trivial, du parler enfantin à la langue folklorique de la parentèle ou de « Pasque » (une voisine qui s’emmêle avec les mots et fait beaucoup rire la famille). Elle charrie tout un vocabulaire de bigoterie catholique et en même temps un prosaïsme narquois et ancré dans la terre. Elle change aussi sans cesse de pronom, glissant du « il » au « tu » ou au « je », pour figurer, sans doute, l’identité encore incertaine de Marcus, et la passerelle entre cet enfant du passé et le narrateur qui est tout à la fois lui et un autre.
Elle s’adresse souvent à « Maman » qui est comme le destinataire du livre — de la même façon que Ma deuxième peau était un hymne à la figure du père. De très nombreux passages du récit décrivent le contact très étroit entre le petit garçon et sa mère, elle qui mobilise tous les sens de Marcus, et les éveille en même temps. Il me semble au reste que c’est le seul personnage dont il est impossible de trouver le prénom dans le récit (mais je n’ai peut-être pas fait assez attention). La figure de papa-Hilaire est en retrait, mais pas absente :
Papa, qui sent le dehors et les occupations. Qui à midi frotte les miettes de pain aux coins de sa bouche et vient s’asseoir d’un côté du lit, les bras encore mouillés de travail. Boucher des trous. Nettoyer des gouttières qui fuient. Grand-maman a une peur bleue des murs humides et de leurs vapeurs. C’est mauvais pour l’eau dans ses jambes, remplies jusqu’au bord dans leurs bandages, comme des citernes d’eau de pluie.
« Quand tu seras guéri, chuchote papa, je te donnerai un petit frère. Ou une petite soeur. C’est aussi bien... »
Guéri, comme les chemises après la lessive : séché, blanchi, repassé. Amidonné, et zou! dans l’armoire.
« Qu’est-ce que tu aimes le mieux ? »demande papa.
Il pose sa main sur le bras de papa, tout froid de la sueur du travail. Il s’accroche à ses épaules et referme ses bras sur sa nuque. (p. 27)
Comme dans ses romans précédents, Erwin Mortier déploie toute une galerie de personnages cocasses, dans une ambiance qui rappelle des scènes de Bruegel mâtinées d’un sens extraordinaire de la dérision (laquelle semble un trait commun à la famille du petit garçon).
« Jésus Marie Joseph, soupire grand-maman. Je crois que les Français sont arrivés ! »
Elle est assise au milieu de l’agitation sur sa chaise à côté du poêle et redresse la tête parce que, avec des épingles à cheveux, maman lui arrime sur le crâne son chapeau, une pâtisserie feuilletée aussi précieuse que sur sa propre tête.
Sur les pavés résonne d’abord le fracas d’un moteur préhistorique en proie à une quinte de toux fatale. Devant les fenêtres du côté rue oscille une cabine dans laquelle des silhouettes sont ballottées. Un crépitement retentit, puis un boum ! Une fumée bleue se déroule au-dessus des tablettes de fenêtre et quand elle se dissipe, c’est la benne qui se balance devant la fenêtre.
« Oui, oui, dit maman, avec une épingle au coin de sa bouche. C’est eux.
- Je vais ouvrir, dit Irène.
- Le chou-fleur de Bailleul est venu aussi ? » crie grand-maman dans le dos d’Irène, et maman chuchote, effrayée : « Mère... »
Grand-maman plisse les yeux et hausse les épaules.
Le chou-fleur de Bailleul est venu aussi. Il a l’air très rose pour un chou-fleur, avec ce petit tailleur saumon qui laisse tout le monde muet à son entrée dans la pièce, avec des bas de soie blanche et un décolleté « carrément scandaleux », glisse, mine de rien, grand-maman.
« Jérôme, dit grand-père en se levant pour saluer les deux hommes derrière le chou-fleur. Albert. Soyez les bienvenus. »
Ils ôtent tous les trois leur casquette. Se prennent par les épaules. S’embrassent sur la joue.
Un moment après, il n’y a plus personne qui sait encore les distinguer. Ils sont de petite taille, grisonnants et presque chauves, ils ont le même nez pointu, des yeux couleur d’ambre qui flamboient sous leurs sourcils en poils de brosse et ils regardent toujours sévèrement, juste comme grand-père. Lui, ne doit jamais ouvrir la bouche quand il est fâché. Un regard suffit.
« Mettez-vous », dit-il maintenant, trop solennellement.
Personne ne sait exactement non plus auquel des deux appartient le chou-fleur, à Jérôme ou à Albert. Papa dit toujours qu’eux-mêmes ne le savent probablement pas au juste, ni de qui est le gamin, il ne serait pas étonné qu’elle ne le sache pas elle-même... (p. 82-84)
Cet extrait est sans doute emblématique du travail de brouillage qu’opère Erwin Mortier entre regard enfantin et regard adulte, habitus familial et style narratif individuel, voix des uns et voix des autres. Les limites sont floues, entre la conscience de l’enfant et celle des adultes, entre la vie et la mort, la veille et le sommeil, etc. Cet indistinct n’est pas seulement une façon de mimer la conscience d’un petit garçon, c’est aussi un regard poétique sur le monde, qui jette le trouble dans les reflets les plus nets. C’est sans doute aussi une façon de dire que la poésie se ressource dans la réminiscence d’un regard d’enfant. Mais on retrouve l’indistinct sous une autre forme dans un monologue ahurissant de la grand-mère, occupée à ranger de vieux habits au grenier avec sa sœur (chapitre 7, pages 69 à 76). Cette étrange vaticination sur le passé m’a rappelé L’Inquisitoire de Robert Pinget (et pas du tout Joyce, pour le coup !), avec cette parole ivre à la fois prosaïque et à la limite du compréhensible. C’est toute l’histoire familiale qui jaillit alors, avec des sautes temporelles, des allusions, des coqs à l’âne, spectacle face auquel le lecteur partage sans doute l’incompréhension de Marcus, tapi dans un coin.
Pour autant, il n’y a aucun hymne à l’irrationalité dans tout cela, tant les fantaisies des personnages font contraste avec l’extrême précision du travail de l’écrivain. Ici plus que jamais, la posture d’Erwin Mortier rappelle celle de Nabokov, cette attention démiurgique qui ne laisse rien au hasard. Ce ne serait d’ailleurs pas la seule proximité entre l’un et l’autre, mais je n’ai pas envie de gloser savamment sur un rapprochement qui doit aussi beaucoup à mes propres affinités littéraires…
Face à un aussi beau livre, j’aurais presque envie de tout citer. Je pense pourtant qu’il faut à un moment clore le catalogue, en espérant avoir donné à de nouveaux lecteurs l’envie de se plonger dans ces pages étincelantes de beauté, d’humour et de style. Bien entendu, il y a toujours l’angoisse d’avoir tu tel ou tel aspect essentiel du récit. Mais après tout, il s’agit d’éveiller un désir, pas de le satisfaire !
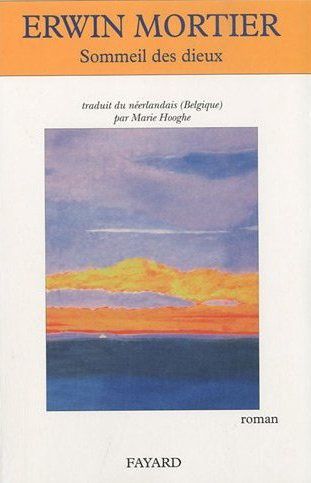 Je viens de découvrir par un amusant hasard la parution d'une nouvelle traduction d'Erwin Mortier aux éditions Fayard, Sommeil des dieux, toujours grâce aux bons soins de Marie Hooghe. C'est la traduction de Godenslaap, initialement paru en 2008 chez De Bezige Bij (éditeur néerlandais installé à Amsterdam). Je ne saurais dire assez haut la reconnaissance que j'ai pour le travail d'une traductrice et la ténacité d'un éditeur qui, depuis 2003, ont offert au public francophone cinq ouvrages d'un écrivain absolument incroyable, et cela alors que bien rares sont les organes de presse qui défendent bec et ongles Erwin Mortier (à part Libération et Le Matricule des Anges, quels sont-ils ?).
Je viens de découvrir par un amusant hasard la parution d'une nouvelle traduction d'Erwin Mortier aux éditions Fayard, Sommeil des dieux, toujours grâce aux bons soins de Marie Hooghe. C'est la traduction de Godenslaap, initialement paru en 2008 chez De Bezige Bij (éditeur néerlandais installé à Amsterdam). Je ne saurais dire assez haut la reconnaissance que j'ai pour le travail d'une traductrice et la ténacité d'un éditeur qui, depuis 2003, ont offert au public francophone cinq ouvrages d'un écrivain absolument incroyable, et cela alors que bien rares sont les organes de presse qui défendent bec et ongles Erwin Mortier (à part Libération et Le Matricule des Anges, quels sont-ils ?).
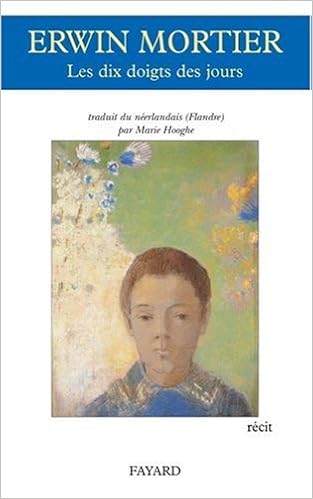


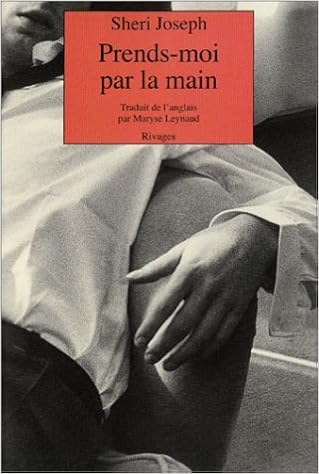
 Yves Navarre, Le Jardin d’acclimatation
Yves Navarre, Le Jardin d’acclimatation