Prends-moi par la main [trad. Maryse Leynaud], Rivages, 2003.
J’ai déjà un peu parlé de ce roman de Sheri Joseph sur ce blog (voir mes livres de chevet). Je l’ai lu traduit en juin 2005 et j’en gardais un souvenir extrêmement fort. À de nombreuses reprises, je l’ai offert autour de moi. Curieusement, j’ai eu peu de réactions, sinon une assez négative récemment. Lorsque, au printemps 2007, est sorti Stray — qui fait suite à Bear Me Safely Over — je l’avais précommandé depuis au moins deux mois. Je me suis vite épuisé sur une langue anglaise très riche, dont le caractère ardu était renforcé par le flou de mes souvenirs sur son prédécesseur. C’est à cette époque que Sheri Joseph a ouvert une page sur Myspace et m’a invité à devenir friends (cet euphémisme myspacien). Nous avons échangé quelques bricoles. Elle m’a conseillé de relire Prends-moi par la main, en v.o. cette fois, avant de me lancer dans les 400 pages de son sequel.
En garçon docile, je me suis exécuté ces jours derniers, conservant à portée la traduction de Maryse Leynaud. L’expérience d’une lecture bilingue est toujours assez redoutable : je trouve toujours l’original anglais plus rêche, moins joli, que la version française. En l’occurrence, au regard de mes compétences restreintes, je trouve le travail de Maryse Leynaud extrêmement rigoureux et aussi littéral que possible. Et pourtant, malgré cela, je n’ai pas retrouvé la poésie douce que j’avais goûtée dans ma lecture initiale. Même effet (et même déception ?) qu’à la lecture de Dream Boy de Jim Grimsley. Je ne sais s’il me faut incriminer mes lacunes en anglais ou si c’est un effet fatal de l’écart entre les deux langues. De fait, le vocabulaire qui me manquait est peut-être celui qui m’aurait fait ressentir une dimension poétique. Curieusement, je n’ai jamais ressenti le même genre de phénomène quand je traduisais des écrivains russes il y a quelques années. La déperdition poétique était plutôt dans l’autre sens. Je n’épilogue pas sur le sujet et m’en vais désormais parler du roman.
Prends-moi par la main est un roman en forme de puzzle. Le sentier que l’on emprunte n’est pas celui d’une histoire linéaire, mais la visite successive de personnages qui ont chacun leur histoire, leur trajectoire. À l’origine, cinq chapitres du livre ont été publiés de façon autonome dans des revues, sous la forme de nouvelles. Le roman regroupe au total neuf chapitres relativement courts et une pièce principale plus longue, “Rapture” (« Extase », un tiers de l’ensemble), elle-même fragmentée en séquences de quelques pages. La plupart des chapitres brefs expriment le point de vue de l’un ou l’autre des personnages principaux, à la première personne, et tous ne se passent pas au même moment. Huit d’entre eux sont disposés avant la pièce centrale et un après celle-ci, qui constitue l’épilogue du livre. Le troisième chapitre de l’édition originale, “Absolute Sway” (Une emprise absolue), n’a pas été traduit — décision des éditeurs français. Ce texte relève d’une inspiration assez particulière : il épouse la voix d’une jeune fille born again (baptiste) qu’on ne retrouvera pas plus tard dans le roman et qui a été le témoin d’une phase religieuse, intense mais brève, chez l’un des personnages principaux, Sidra. C’est une magnifique dissection à froid (sans jugement) de l’embrigadement religieux. Sheri Joseph m’a dit qu’on lui avait expliqué que ce chapitre serait « culturellement incompréhensible » pour des Français. Je déteste l’idée même d’avoir caviardé un chapitre, fût-il superflu dans l’économie narrative…
Le titre original pourrait se traduire par quelque chose comme « Tiens-moi à l’abri (des dangers) » ou « Prenez-moi sous votre protection », ce qui ne serait pas très joli en v. f. C’est littéralement et exactement le thème du roman. Celui-ci se passe dans l’État de Géorgie (aux États-Unis), l’un des bastions des fondamentalistes religieux (baptistes, ici). Un garçon de dix-sept ans, Paul, à l’orientation sexuelle précoce et sans ambiguïtés, réunit autour de lui l’énergie de plusieurs personnes qui voudraient le sortir des griffes du destin qui semble le menacer : homophobie, SIDA, répression judiciaire, mort violente… Dès l’enfance, abandonné par sa mère et élevé seul par son père, le garçon a manifesté des signes peu équivoques :
« Jonathan! » s’égosilla encore le petit garçon, avant que Dan ne trouve quelque chose à répondre. Ce n’était pas une voix qu’on pouvait ignorer : elle était plus riche que sa voix normale, plus nasale, avec de drôles d’inflexions — anglaises ? Dan pensa à une duchesse convoquant son domestique, à une vieille mère aristocratique appelant son fils.
Il traversa le jardin jusqu’ à la véranda, où le petit garçon était toujours assis, impassible, et le regardait en clignant des yeux, les bras autour de ses jambes croisées. La bordure en satin bleu de la couverture encadrait son visage. Le reste cascadait sur ses épaules et s’amoncelait en corolle sur le béton derrière lui, soigneusement arrangé comme une traîne de mariée.
« Paul. » Dan prononça le nom de son fils avec sollicitude, car il y avait quelque chose comme une étrange métamorphose, un air de madone, dans le voile bleu et les yeux placides en dessous. « Viens aider ton vieux papa à ramasser les feuilles.
— Enfin, Jonathan, est-ce que c’est une façon de me parler, à moâ ? gazouilla l’enfant, les traits comiquement étirés entre sa moue et ses sourcils levés. Vous devriez m’appeler Miss Pritchett. » Il fit glisser le bout de ses doigts sur les contours délicats de son visage, d’un côté puis de l’autre, tranquille, précis.
Dan tenta de sourire, malgré le tressautement nerveux de son estomac. […]
« Je suis divine. Tout simplement sublime », annonça Miss Pritchett. Une main dégagea une épaule des plis de la couverture, et la tête bleue s’inclina sur la gauche en fronçant les sourcils, comme s’il cherchait un autre adjectif. « Jonathan, vous devriez me dire comment vous me trouvez. »
Dan éprouva le désir de satisfaire son fils, il fouilla un tourbillon de mots à la recherche d’une description. Mais rien ne paraissait approprié. « Miss Pritchett, finit-il par dire. Si vous remettiez la couverture sur le lit ? »
Miss Pritchett leva des yeux ronds au ciel, mais sous sa maussaderie scintillait le sourire d’elfe de l’enfant. « Ne soyez pas stupide, Jonathan, espèce d’idiot. Vous avez le don de m’exaspérer. »
Dan éclata de rire en relâchant son souffle. Il ne pouvait s’en empêcher. D’où sortait-il tout cela ? Le petit garçon inventait, jouait, imitait peut-être quelque chose qu’il avait vu à la télé. Bien d’autres merveilles tournaient chaque jour dans cette cervelle. Comment un adulte pouvait-il être à la hauteur ? […] (p . 59-60)
Dan Foster, plus tard, s’est remarié avec une femme, Muriel, mère d’un garçon de huit ans plus âgé que Paul, Curtis — qui très vite a rejeté son frère d’adoption, ce « petit pédé », avec une peur panique de la « contagion ». L’essentiel du récit se passe durant la dix-septième année de Paul, alors que Curtis mène sa propre vie, a une petite amie — Sidra — et joue dans un groupe de rock basé à Athens (la ville de R.E.M.). La jeune femme est l’autre personnage majeur du roman, parce qu’elle a noué des liens forts avec Paul.
Ce n’est pas uniquement pour punir Curtis que je me suis mise à traîner avec Paul, son demi-frère — Curtis préfère n’importe quel autre terme plutôt que « frère » ou ce qui s’en rapproche, avec une prédilection particulière pour le mot « pédé ». J’essaie de lui rappeler qu’ils ne partagent pas la moindre goutte de sang, mais Curtis s’entête: « Quand même », et il frissonne des pieds à la tête. Curtis a décrété que le sujet Paul […] est clos à toute intervention de ma part. Il supporte à peine d’être dans la même pièce ; on voit la violence monter en lui comme une nausée. Et c’est pitoyable de voir Paul faire des pieds et des mains pour plaire à Curtis. […]
En plus, Paul a besoin qu’on s’occupe de lui. Il me fait penser à un jeune pur-sang arabe, rétif, ombrageux, et un peu trop intelligent pour l’écurie. Je crois que sa famille a un peu peur de lui, en réalité, ils font comme s’il s’agissait d’un animal intéressant et le laissent sortir parce qu’ils ne savent pas trop quoi faire de ce gamin si exotique. Pas gay, bien sûr. Ils n’en ont pas, des comme ça. Je ne suis pas sûre qu’ils avoueraient connaître le mot. (p. 109)
Je donne des cours d’équitation à Paul. Je selle une des vieilles juments de ma mère et lui mets une longe pour qu’elle trotte en cercle autour de moi. Paul a trouvé tout de suite la position correcte, donc on est passés au trot assis. « Tu t’en sors très bien. Tu es doué », lui dis-je. Ses genoux remontent subrepticement pour enserrer la selle, mais il les force à redescendre sans que je lui dise. Détends-toi. Détends-toi. L’effort pour se détendre sans tomber fait affluer le sang sous ses pommettes.[…]
Ses mains reposent sur ses cuisses gainées de daim, comme je lui ai expliqué. Chaque soubresaut représente un effort pour conserver la minuscule étendue de jean encore découverte collée à la selle. « Ces autres selles, demande-t-il avec une grimace, boing boing boing, elles sont plus rembourrées ?
— Tu n’as pas besoin de rembourrage. Tu as seulement besoin d’acquérir le mouvement, tu dois pousser en avant avec le bas de ton dos. » D’humeur narquoise, j’ajoute ce détail précieux que mon ancien prof de dressage utilisait pour capter l’attention des adolescentes : « Comme quand on fait l’amour. »
Paul éclate de rire et perd l’équilibre, il agrippe le pommeau pour se retenir, et pendant ce temps je me demande : est-ce que ça paraît vraiment stupide ? […] J’ai un peu peur qu’il commence à m’expliquer que j’ai tout faux, et je ne suis pas sûre d’avoir envie de savoir, surtout par Paul, qui n’est qu’un gamin et ne connaît sûrement pas encore la technique, de toute façon. Encore que si, probablement.
Mais il dit : « Je vais devoir répéter ça à Curtis.
— Tu parles. Il me l’a déjà entendu dire. Je lui ai appris à monter, à lui aussi, tu sais. »
Il se met à ricaner. « Pitié, Sidra, je n’ai pas envie de connaître tous tes vilains secrets de plumard. Tu vas me faire tomber. » Il a le visage brillant, un sourire si large maintenant qu’il paraît douloureux. De nouvelles taches pourpres se répandent sur sa peau claire, pie, bizarrement séduisante : un V couleur rubis sur sa poitrine, s’élevant du col échancré de sa chemise. […]
La ferme — la maison de ma mère, et la mienne à nouveau, maintenant — reçoit une douce brise venue des champs, même en été, mais il fait trop chaud pour continuer comme ça. Je me dis qu’à l’automne les leçons pourront durer plus longtemps. Je me demande si Paul veut vraiment apprendre, ou s’il ne vient que pour s’échapper de Greene County le temps d’une journée. À sa façon de parler de là-bas — sans haine mais avec une sorte de détachement, ou au passé —, je me demande s’il ne risque pas de faire une fugue, alors qu’il ne lui reste qu’une année de lycée. À l’automne, il sera peut-être déjà parti. (p. 111-113)
Régulièrement, Paul disparaît et part sur les routes, monnayant ses déplacements par des faveurs dont il est insatiable. Sa destination préférée est Atlanta, où il se retrouve hustler (prostitué) un peu malgré lui. Tout cela, sa famille ne fait que le deviner jusqu’au moment où il est pris en flagrant délit par un policier. À partir de là, la rumeur se répand dans le Greene County où habitent son père et sa belle-mère. La vie de Paul est menacée par l'intolérance générale et sa seule issue semble être la fuite. Sidra — dont la petite sœur Marcy est devenue fugueuse des années auparavant, avant de rentrer chez elle mourir du SIDA — prend particulièrement à cœur le sauvetage du garçon. Mais rien n’est gagné, entre l’hostilité de Curtis, les risques de la ville et le tempérament insatiable de Paul, comme inconscient des dangers qui le guettent.
Sheri Joseph tisse un parallèle entre les trajectoires de Marcy et de Paul tout au long du roman. La défunte est comme un fantôme qui flotte au-dessus de Sidra et de sa mère, Florie Ballard (autre personnage important). Un chapitre halluciné raconte à la première personne l’adolescence fugueuse de la jeune fille, au rythme de ses échappées et de son attirance irrésistible pour les villes. Chacun à leur époque, les deux adolescents sont des “hummingbirds” (colibris), irrésistiblement attirés par des lieux mortels, et s’y ruant inlassablement. Entre désir de ne pas refaire les mêmes erreurs et souci de laisser Paul trouver un équilibre, la mère et la fille reconstruisent leur propre relation, ruinée depuis longtemps.
Bear Me Safely Over a été un succès critique et public aux États-Unis, traduit rapidement dans plusieurs langues, dont le français. Inévitablement, on a rattaché le livre à la tradition des romans « sudistes », ce qui me semble relativement bébête, car il s’agit plutôt d’un roman intimiste, dessinant une géographie psychologique qui se suffit d'un décor à peine esquissé. Ce n’est pas pour rien que les chapitres suivent tel ou tel personnage : l’essentiel de ce que l’auteur dit ou fait dire aux personnages est affaire de relations inter-individuelles, d’émotions, de jugements moraux. Il est très rare que la focale s’élargisse pour montrer un paysage plus vaste, sinon sous la forme de notations économes. Une adaptation théâtrale, à condition de ne pas lésiner sur les monologues, serait assez aisée, tant l’environnement est à la limite de l’abstraction. Non pas que le climat spécifique de l’Amérique puritaine sudiste soit superflu ; il est au contraire déterminant. En revanche, c’est une présence sous-jacente, une chape qui pèse sur la trajectoire des personnages. Mais cet environnement est très peu figuré, sauf en quelques moments clés (mais brefs).
Kent followed the sound into the barn where Paul vanished, where the darkness deepened, and he couldn’t tell a shadow from a solid thing. He stopped, started forward again, hand trailing a rough wall. Close by, a horse blew, took muffled steps. He could smell the animal’s flesh, the quick sweat of his own skin. He didn’t know if he was chasing a shadow or becoming one, stilling his breath so he could melt into darkness; but he moved slowly forward until he felt himself enter a sort of balance with the dark, and his hands lashed out. Before his eyes ever adjusted, he had hold of the boy, both upper arms in his grip.
Paul let out a startled sound — a thin, girlish squeal. ‘Hold still,’ Kent said, though Paul didn’t struggle. The only answer was a deepening of breath, and Kent thought he could feel it, warm and then cool against his throat. He let go, stepped back. Afraid the boy might bolt again, he left the fingers of one hand resting on the white shirt, which was gauzily visible, all he could see. Then he took the hand away too.
In letting go, the tight ache of his chest eased a little, and Paul relaxed as well. ‘What are we doing out here?’ Kent asked, the echo of the laugh ringing his voice. Perhaps they were conspiring in some prank against the others.
‘Why are you whispering?’ Paul whispered.
‘I don’t know. The horses. Why do you keep laughing?’
‘I can’t help it.’
‘Tell me the joke.’
‘I’ll tell you later. Maybe.’ Paul stepped closer, brushed slowly past. ‘I want to show you something.’
He took Kent’s hand as he passed, took hold of it firmly and easily and offered no alternative, as if this were the normal way for one man to guide another through a dark place. He led him to a ladder and began to climb. Above was a blackness the quality of velvet, and even the white shirt was consumed as it rose. How odd it felt to hold the boy’s hand, odder still to be released so suddenly, to be climbing now higher than he thought the barn should go, as if they were no longer in the place where they’d started. But he never felt as if he were falling, even when the ladder ended and he was pulling himself up onto a platform that he couldn’t see, into a loose bed of hay that he could only feel and smell under his hands. Where Paul waited.
In that absolute black silence, unruptured by anything other than touch, he could have been anywhere, with anyone. He might have been drunk or half-dreaming in his own bed, and Paul, when he reached him, found him, might have been a girl for all the skin his fingers found — taut rib cage, shallow gully of spine, flank in denim. By touch, inhabitants of a sightless world, they became something other — a meeting of bodies, of mouths, and then only Paul’s mouth, on his throat, his chest and stomach. So slow and careful, even tender, as if they knew each other.
What happened in the loft was more than Kent wanted and more, he knew now, than where it ended — the somehow canceling act of fellatio. He recalled the very quality of the boy’s skin. (p. 193-195 de l’édition en anglais)
Il y a quelque chose de chirurgical dans la découpe des événements, mêlant le cru et l’elliptique à bride abattue. L’auteur a également le don de la densité : en très peu de mots elle installe une grande diversité d’ambiances et d’émotions. Et si certains détails sont analysés à la manière d’un roman intimiste à la française, d’autres aspects, bien plus nombreux, sont seulement suggérés. Il en va ainsi des attitudes adolescentes de Paul, décrites dans un mélange de fascination explicite et d’ironie latente. Ce n’est qu’un exemple des ambivalences innombrables d’un roman qui ne pousse par ailleurs aucun de ses personnages vers un statut manichéen. La plupart sont d’ailleurs touchants et imparfaits. On atteint là ce mélange trouble de réalisme et d’optimisme qui sous-tend le livre, cette idée tenace que dans un univers marqué par diverses horreurs (l’intolérance, l’homophobie en particulier, le SIDA, la drogue, la pauvreté, etc.), il y a toujours (ou presque) une corde d’humanité à faire vibrer chez les individus.
Cette position morale, que je devine enracinée dans un christianisme qui n’est ni intégriste ni prêchi-prêcha, a peut-être fait ou pourrait faire ricaner certains. Pourtant, le roman aborde en permanence des sujets très durs et très contemporains, et sans la moindre forme de niaiserie. Mais sans jamais non plus se départir de cette inclination pour l’espoir et le mieux.




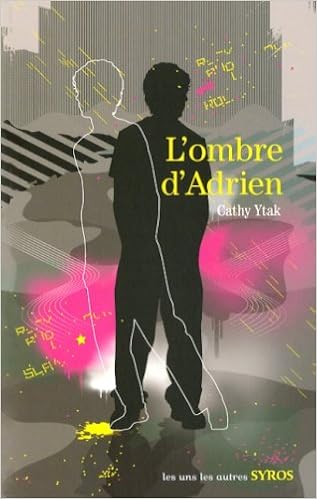

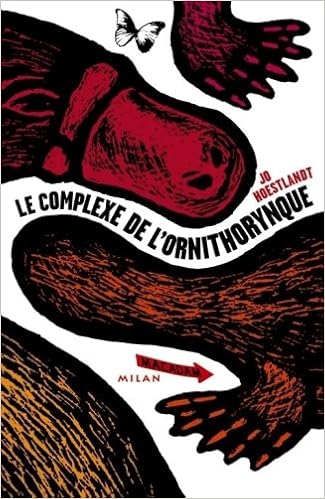
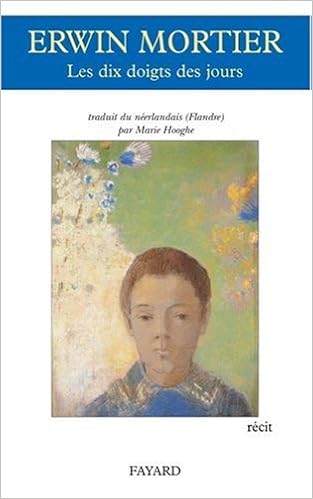

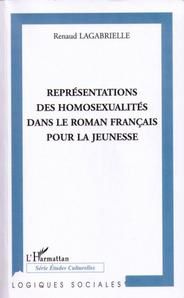 Il s’agit de la version publiée « remaniée et fortement raccourcie » d’une thèse soutenue à l’université de Vienne (Autriche). Le texte actuel fait un peu moins de 300 pages. Le corpus : trente ouvrages en français parus entre 1989 et 2003 dans des collections jeunesse. Il n’y a pas de références francophones non françaises, en revanche quelques traductions sont brièvement évoquées : Frère de Ted Van Liehout et Mon frère et son frère de Håkan Lindquist. Le livre est à l’intersection de deux cultures, les « études gaies et lesbiennes » (gay and lesbian studies) et la critique littéraire (aspect sur lequel je reviendrai). J’ignore pour quelles raisons cette thèse a été soutenue en Autriche et non en France. Cela pourrait être une conséquence de l’hostilité supposée de l’université française à tout ce qui paraît par trop « communautaire ».
Il s’agit de la version publiée « remaniée et fortement raccourcie » d’une thèse soutenue à l’université de Vienne (Autriche). Le texte actuel fait un peu moins de 300 pages. Le corpus : trente ouvrages en français parus entre 1989 et 2003 dans des collections jeunesse. Il n’y a pas de références francophones non françaises, en revanche quelques traductions sont brièvement évoquées : Frère de Ted Van Liehout et Mon frère et son frère de Håkan Lindquist. Le livre est à l’intersection de deux cultures, les « études gaies et lesbiennes » (gay and lesbian studies) et la critique littéraire (aspect sur lequel je reviendrai). J’ignore pour quelles raisons cette thèse a été soutenue en Autriche et non en France. Cela pourrait être une conséquence de l’hostilité supposée de l’université française à tout ce qui paraît par trop « communautaire ».