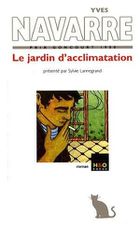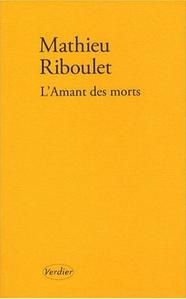André Aciman, Plus tard ou jamais, traduit de l’anglais (USA) par Jean-Pierre Aoustin, éditions de l’Olivier, 2008.

En un lieu comme un autre de la Riviera italienne, dans un passé vieux de vingt ans, Elio revient sur l’été de ses dix-sept ans et la liaison qu’il vécut alors avec Oliver, un jeune universitaire américain reçu en résidence chez ses parents. Même si aucune étiquette ne vient frapper cette histoire, il s’agit sans doute d’un des plus beaux romans d’amour entre deux hommes qu’il m’ait été donné de lire ces dernières années. L’homosexualité est une dimension ambiguë du livre (au reste, les deux protagonistes pourraient être considérés comme rigoureusement bisexuels…), à la fois fondamentale et comme tenue à distance par le narrateur (Elio a au moins trente-sept ans lorsqu’il la raconte).
Le lendemain on joua au tennis en double et, pendant une pause, alors que nous sirotions les citronnades de Mafalda, il posa sa main libre sur mon épaule et la pétrit doucement, en un simulacre de massage amical. Le tout très copain-copain. Mais j’étais si subjugué que je me dérobai vivement à son emprise, parce qu’un moment plus tard je me serais ramolli comme un de ces petits pantins articulés dont le corps s’effondre dès qu’un ressort est touché. Surpris, il s’excusa et me demanda s’il avait pressé « un nerf ou quelque chose » — il n’avait pas voulu me faire mal. Il devait se sentir mortifié s’il pensait qu’il m’avait fait mal ou touché d’une manière gênante pour moi. La dernière chose que je voulais, c’était le décourager. Je bredouillai quelque chose comme « Ça ne m’a pas fait mal », et j’en serais resté là, mais si ce n’était pas la douleur qui avait provoqué une telle réaction, qu’est-ce qui pouvait expliquer que je m’étais écarté si brusquement de lui devant mes amis ? Alors j’adoptai l’expression de quelqu’un qui s’efforce, vainement, de cacher une grimace de douleur. (p. 25-26)
Cela pourrait se passer dans les années 1980, n’en déplaise aux efforts de l’auteur pour estomper l’ancrage du récit dans une époque précise (sinon son épilogue). La villa familiale forme un havre paradisiaque, ouvrant sur d’autre coins (« spots ») égrenés dans les environs : la ville de « B », sa piazzetta et son afflux humain, le « tertre de Monet », refuge d’Elio, la plage où Shelley s’est noyé, et encore d’autres accès à la mer… Cette existence estivale, simplifiée à l’extrême, ouvre de vastes plages de loisirs et de rêverie. Tout l’effort de réminiscence dont le livre est fait s’attache à celles-ci, sous le regard souverain d’un garçon de dix-sept ans, ses conjectures, pulsions et répressions.
La souffrance et la joie d’une nouvelle rencontre, la promesse de tant de bonheur presque à portée de main, les tâtonnements maladroits avec des gens sur lesquels je pourrais me méprendre, que je ne veux pas perdre et dont je dois sans cesse anticiper les réactions, ma ruse désespérée avec ceux que je désire et dont je rêve d’être désiré, les écrans que je dresse si bien que, entre moi et le monde, il semble y avoir non pas une seule mais plusieurs portes coulissantes en papier de riz, l’envie de brouiller et débrouiller ce qui n’a jamais été vraiment codé en premier lieu — tout cela a commencé l’été où Oliver est venu chez nous. C’est dans chaque chanson qui fut un succès cette saison-là, dans chaque roman que je lus pendant et après son séjour, dans toute chose, de l’odeur de romarin quand il faisait très chaud au chant effréné des cigales l’après-midi — odeurs et sons avec lesquels j’avais grandi et que j’avais connus chaque été de ma vie jusque-là, mais qui prenaient soudain un relief inhabituel et évoqueraient à jamais pour moi les événements de cet été-là. (p. 19)
Ou bien, quand je ne m’exerçais pas à la guitare et qu’il n’écoutait pas de la musique avec son casque sur les oreilles, toujours avec son chapeau de paille sur le visage, il rompait soudain le silence :
« Elio.
- Oui ?
- Que fais-tu ?
- Je lis.
- Non, tu ne lis pas.
- Je pense, alors.
- À quoi? »
Je mourais d’envie de le lui dire.
« C’est personnel, répondais-je.
- Alors tu ne me le diras pas ?
- Alors je ne te le dirai pas.
- Alors il ne me le dira pas », répétait-il pensivement, comme s’il expliquait la chose à quelqu’un d’autre.
Comme j’aimais cette façon qu’il avait de répéter ce que je venais moi-même de répéter. Cela me faisait penser à une caresse, ou à un geste totalement accidentel la première fois mais qui devient intentionnel la deuxième et encore plus la troisième. Cela me rappelait la manière dont Mafalda faisait mon lit chaque matin, d’abord en repliant le drap du dessus par-dessus la couverture, puis en le repliant encore sur les oreillers, et une fois de plus sur le couvre-lit, si bien que j’avais le sentiment qu’il y avait là entre tous ces plis la promesse de quelque chose d’à la fois fervent et indulgent, tel un consentement dans un instant de pardon. (p. 39-40)
Ce fut, je pense, la première fois que j’osai vraiment le regarder dans les yeux. D’ordinaire, je jetais un coup d’oeil et puis je détournais les miens — parce que je ne voulais pas nager dans l’eau claire de ses yeux sans y avoir été invité, et je n’attendais jamais assez longtemps pour savoir si ma présence y était souhaitée; parce que j’étais trop effrayé pour regarder quiconque dans les yeux ; parce que je ne voulais pas me trahir ; parce que je ne pouvais pas m’avouer à quel point il comptait pour moi. Et parce que ce regard dur qu’il avait parfois me rappelait toujours combien il m’était supérieur et comme j’étais loin au-dessous de lui. Maintenant, dans le silence de ce moment, je le regardais en face, non pour le défier, ou pour lui montrer que je n’étais plus timide, mais pour capituler, pour lui dire voilà qui je suis, voilà qui tu es, voilà ce que je veux, il n’y a plus que la vérité entre nous, et là où se trouve la vérité il n’y a pas de barrières, pas de regards fuyants, et si rien n’en sort, qu’il ne soit pas dit que nous ignorions toi et moi ce qui aurait pu arriver... Je n’avais plus le moindre espoir. Et peut-être le fixais-je ainsi parce que je n’avais plus rien à perdre. C’était le regard pénétrant, « je-te-défie-de-m’embrasser », de celui qui brave et fuit d’un seul et même mouvement. (p. 97-98)
Pourtant, la prose infiniment souple, riche, ductile de ce roman n’a besoin d’être rapprochée d’aucune autre. Elle permet autant un plaisir au premier degré (car l’histoire est belle comme un paysage dégagé et changeant) qu’une lecture sophistiquée, assez nabokovienne (avec ses indices, ses jeux de miroirs, ses pièges). La traduction de Jean-Pierre Aoustin a gardé toute la jubilation et la souplesse du texte original. Grâce à quoi, rarement le sentiment de déperdition d'une langue à l'autre n’aura semblé aussi faible. À la restriction du titre cependant : Call Me By Your Name (« Appelle-moi par ton nom »), version originale, renvoyait à l’une des lubies érotiques d’Elio et Oliver (sous le signe de l’interversion des noms, des vêtements, des corps…). L’édition française a préféré une autre phrase redondante du roman (If not later, when ?), que le narrateur attribue à son moi de jeunesse comme un « schibboleth » — soit, en hébreu, un trait linguistique qui permet de distinguer un locuteur, ou « une épreuve décisive qui permet de juger de la capacité d’une personne » (selon le site le mot du jour). À travers cet exemple, néanmoins, émerge une autre facette d'un roman qui en comporte tant : sa façon gourmande d'entrecroiser diverses cultures et de les faire résonner ensemble.
Rajout ultérieur : je voudrais signaler une interview en ligne (en anglais) d'André Aciman que j'ai découverte depuis que j'ai posté cette présentation. Elle m'a ouvert de nouvelles perspectives, tout en confirmant (il me semble) un certain nombre d'intuitions (concernant le prosaïsme du roman, notamment). La navigation m'a aussi permis de faire quelques mises au point : contrairement à ce que dit la 4e de couverture, l'auteur n'est pas un spécialiste de Proust : il a juste dirigé un livre qui recueille l'expérience de lecture que celui-ci a représenté pour des écrivains. Mais son champ de compétence académique serait plutôt la littérature des XVIe et XVIIe siècles, notamment française.